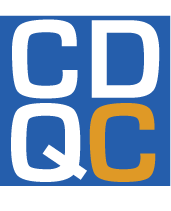
La Saint-Valentin, fête des amoureux
Par Donat Gagnon.
Dans la pensée populaire, la Saint-Valentin est sans contredit la fête des amoureux. Peut-être sous la pression de la mode, jeunes et vieux se préparent à célébrer cet évènement. Pour les couples déjà constitués, c’est l’occasion du rappel des souvenirs de rencontre et des bons moments vécus dans leur vie commune. Ceux-là en profitent pour réchauffer l’ardeur de leur passion et de leurs bons sentiments mutuels.
Mais il y a aussi tous les autres qui ne sont pas en couple et qui cherchent l’âme sœur dans celui ou celle qui pourrait correspondre à leurs rêves de fréquentation amicale et affectueuse. C’est parfois compliqué quand on s’expose à connaitre l’épreuve des sentiments et à faire face au mystère de l’autre. Beaucoup de jeunes ne savent faire les premiers pas; ils ont besoin qu’on leur présente quelqu’un. Cela s’est toujours fait et se fait encore dans de nombreux clubs de rencontre. Certaines sociétés ont pris cela comme prétexte pour improviser des mariages sans que les intéressés ne se connaissent; par exemple en Inde. Dans l’Ancienne Rome, il y avait la fête des Lupercales du 15 février (en l’honneur de ‘Lupercus’ dieu protecteur des troupeaux et des bergers) où l’on tirait au hasard le nom de filles et de garçons dans le but de former des couples qui sortiraient ensemble tout le reste de l’année. On ne dit pas ce qui en résultait.
Dans les mythologies gréco-latines il y avait Cupidon le dieu de l’amour qui était représenté sous la forme d’un jeune garçon qui s’était emmouraché de Psyché d’un niveau inférieur. Cupidon avait un arc et des flèches. La légende veut que la première personne qu’il frappait d’une flèche, devenait amoureuse de lui pour toujours. En principe, la personne touchée accédait à un nouvel état, une amélioration de sa condition. Cela illustre en quelque sorte la passion amoureuse d’Éros et de son pouvoir d’exaltation.
Les rapports des couples naissants ont souvent été frappés de règlementations dans beaucoup de sociétés, soit par le moyen de l’initiation, soit par des restrictions pour des raisons militaires. Vers l’an 200 à Rome, l’empereur Claudius fit promulguer une loi qui obligeait les soldats à rester célibataire pour qu’ils ne soient pas tentés de demeurer à la maison avec leur famille et de déserter le service militaire.
Au cours des années 260 le prêtre romain ‘Valentinus’ était d’un avis plus profitable aux couples de sorte qu’il mariait en secret de jeunes couples amoureux. Vers 268 l’empereur Claudius II ne l’a pas vu du même œil, puisqu’il craignait que ces mariages n’affaiblissent son armée. Les historiens rapportent que cet empereur fit arrêter et exécuter ‘Valentinus’ en invoquant la loi promulguée par Claudius I qui obligeait les jeunes hommes potentiellement soldats à rester célibataires.
La tradition des Lupercales a tenu bon jusqu’en 496 lorsque le pape Delasse (Gélase selon la liste des papes publiée dans « Histoire des Papes », Persan-Beaumont, 1949; par Ch. Burgaux) décida de les abolir et d’honorer plutôt la mémoire de ‘Valentinus’ (Valentin martyr) en le déclarant saint patron des amoureux, qui serait fêté le 14 février de chaque année. Il y eut sept saints nommés Valentin tous fêtés le 14 février.
Par conséquent, l’on peut dire que la tradition de la Saint Valentin se rattache d’abord à des mœurs anciennes empreintes de mythologie, ensuite à des personnes qui ont payé de leur vie pour avoir choisi le pouvoir de l’amour plutôt que la puissance du pouvoir. Saint Valentin en est le plus illustre exemple.
Donat Gagnon, 21 janvier 2018.
Source : Ma principale source d’inspiration a été l’article « Saint-Valentin : la Fête et son histoire » publié le 20 janvier 2018 sur le site (ici.radio-Canada).
Des Hommes et des Dieux
Un film qui redonne au cinéma une façon de toucher les cordes sensibles de l'intérieur humain sans déployer les armes et faire du bruit à tout casser.
Par Donat Gagnon.
Le film Des Hommes et des Dieux, Grand prix du Festival de Cannes 2010 et de plusieurs Césars, est une production française de Xavier Beauvois. Le film relate le drame de 7 moines cisterciens assassinés le 30 mai 1996 durant la guerre civile, en Algérie. On n'a retrouvé que leurs têtes mais non leurs corps. L'enquête n'a pas précisé les conditions de leur mort. Le film porte plus précisément sur la question de savoir si les moines doivent quitter ou rester au Monastère de Thibirine, en Algérie ? La guerre civile fait rage dans ce pays; des fonctionnaires de l'État suggèrent aux moines qu'il serait préférable de quitter parce que c'est devenu dangereux d'être là et parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. On les traite en étrangers alors qu'ils demeurent, travaillent et sont liés d'amitié avec les gens du village depuis des décennies. De plus, ils rendent toutes sortes de services aux gens de la place, des chrétiens et surtout des musulmans, service de médecine, d'aide à la communication avec les fonctionnaires de l'État, partage de service en agriculture, etc. Les rencontres interculturelles, les dialogues interreligieux sont favorisés et fonctionnent bien. Voilà pour le fond du décor, mais le cœur du problème est de décider en communauté si on reste ou on part. Christian de Chergé (joué par Lambert Wilson) le prieur du monastère propose que l'on reste. La gravité de la décision amène des confrères moines à réagir à cette façon de décider alors que c'est la vie et la mort de chacun qui est en jeu. « On ne t'a pas nommé prieur pour que tu décides à notre place ! » « C'est le sens même de la communauté qui est en jeu dans la manière où on va prendre la décision. » Les échanges passent cette étape d'hésitation et chacun formule ses réserves ou les arguments qui justifient le fait de partir. Mais ces arguments reposent sur la peur et la soumission à l'armée ou à la terreur. Ils ne sont pas entrés chez les moines pour de semblables motifs. Progressivement, à force de dialogue libre et sincère, les arguments en faveur de rester sont exprimés et acceptés quand ils se rappellent mieux le sens de leur mission. Finalement, ils restent d'un commun accord. Quelque temps plus tard, sept moines seront enlevés (deux y échappent) comme otages pour servir de monnaie d'échange pour la libération des terroristes retenus en France. Je retrouve dans ce film les qualités que j'attends du cinéma : Un niveau sonore convenable, des paroles audibles, un scénario assez évident pour qu'on puisse concentrer l'attention sur l'essentiel d'un problème et du message, une certaine stabilité dans le fond du décor qui donne sens au mouvement de la scène (focus), une idée inspirée de la phénoménologie de la perception. Finalement la manière dont on provoque les émotions des spectateurs est à considérer : les émotions que l'art cinématographique arrive à provoquer servent-elles à élever le niveau des sentiments ? Or ce film a toutes ces qualités. J'achète.
En plus, il faut souligner la qualité des dialogues incarnés dans la réalité concrète des discussions touchant les rapports interculturels, les conflits interreligieux. Il faut voir ce film et entendre son message pour comprendre qu'il y a toujours un espoir, sinon une invincible Espérance. Un tel film agrandit notre champ de vision en nous et hors de nous. À sa manière, ce film redonne au cinéma une façon de toucher les cordes sensibles d'une certaine intériorité des êtres humains sans déployer les armes et faire du bruit à tout casser. Il touche les valeurs de la communauté, de la conscience universelle et de la foi. Lors d'une rencontre amicale, une dame m'interpelle avec cette question : toi Donat dans le contexte des évènements du Thibirine, aurais-tu pris le parti de partir ou de rester ? Ma réponse fut aussi vive que la question qui m'était posée : Tous les arguments en faveur de partir étaient sensés et légitimes d'un point de vue humain. Ils méritaient considérations, dialogues et s'inscrivaient dans un processus d'approfondissement humain. Par ailleurs, les arguments en faveur de rester à Thibirine étaient aussi tout à fait valables si on les examine en considérant l'engagement et la mission que s'étaient donnés ces hommes en s'engageant dans la voie monastique et christique. Ils se demandaient ce qui devait prévaloir : obéir à l'engagement pris au départ, engagement au service de Dieu et des hommes et de la communauté environnante, ou bien obéir par peur (peut-être) à ceux qui leur proposaient la sécurité en fuyant leur milieu d'appartenance et de service ?
Répondre à cette question signifierait aller trop loin dans la divulgation des arguments de ces moines qui cheminaient de façon si exemplaire.
Il faut plutôt voir et entendre ce film pour en apprécier toute la saveur et l'émotion qui se convertit en sentiment supérieur. Si Des Hommes et des Dieux n'est plus présenté en salle dans votre région, il est possible de se le procurer dans un centre de location ou de l'acheter en format DVD ou Blue Ray.
Ce film, Des Hommes et des Dieux, nous resitue nous-mêmes en face des questions essentielles de notre vie.