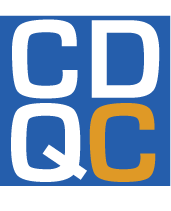
La GRANDEUR DE LA RÉSURRECTION LA VIERGE GUADALUPE EN PAYS MAYA LE SAINT LINCEUL |
||
LA CONQUÊTE DU MEXIQUE ET L'ARRÊT DES SACRIFICES HUMAINS
par Donat Gagnon
Nous abordons le premier d'une série d'articles portant sur le Mexique, sa conquête au temps où cette région du monde était au pouvoir des Aztèques, des Toltèques et des Mayas. D'abord, les conquérants espagnols (conquistadors) ont la mission de prendre possession d'un vaste territoire dans le Nouveau Monde. La prise de celui-ci s'est faite entre le 22 avril 1519 et le 13 aout 1521. Ensuite, un peu plus de dix ans après la conquête définitive du Mexique par Hernàn Cortés, la Vierge Guadalupe du Mexique est apparue à un indien aztèque en décembre 1531. Nous voyons là deux événements très rapprochés dans la mesure où la mission comportait un volet politique et une motivation religieuse. En ce qui concerne la Vierge du Mexique, nous en traiterons dans une deuxième partie à paraître prochainement. Le présent article est un préambule à l'histoire de cette Vierge Guadalupe du Mexique qui motive ma démarche et mes efforts pour la faire connaître.
Dans ce genre de conquête, comment éviter d'user de violence et d'abus de toutes sortes, violence des armes envers des êtres humains, destruction de villes et villages, intimidation et mépris des êtres conquis qu'on dit parfois dépourvus d'âme ? Dans ce contexte, deux civilisations qui s'ignorent complètement s'entrechoquent; des cultures spirituelles ou religieuses cherchent à s'apprivoiser. Néanmoins la probabilité d'échec est extrêmement élevée; d'un côté parce que les conquérants étaient en petit nombre, de l'autre parce que les indigènes auraient pu les renverser malgré la faiblesse de leur armement. Qu'est-ce qui a joué en faveur d'un heureux métissage ?
L'histoire nous apprend que c'est avec une armée assez petite que les Espagnols ont conquis le territoire. Hernàn Cortés disposait de quelque six cents hommes bien armés avec des pièces d'artillerie, d'une cavalerie qui pouvait aussi aider au transport du matériel. Mais avec les bateaux de l'époque, on ne pouvait pas embarquer tout le matériel qu'on aurait voulu apporter. En mettant pied à terre à Veracruz, il dut faire face à une solide résistance et il perdit une partie de son armée. En bon observateur, il comprit qu'il devait adopter une stratégie qui tenait autant de la diplomatie que de la rigueur. Rapidement, il se rendit compte qu'il y avait beaucoup de dissensions au sein des peuplades amérindiennes; celles-ci contestaient le pouvoir indigène en place, au point que des amérindiens souhaitaient se ranger au côté de Cortés pour combattre les partisans de Moctezuma II, l'empereur suprême du pays.
Après la prise de plusieurs villages et l'acquisition d'appuis solides chez les autochtones, il fut convaincu que le lieu sensible à prendre était Tenochtitlan et que Moctezuma II n'était pas aussi pacifique qu'il pouvait le sembler. Par conséquent, Cortès, ses hommes et les autochtones qui s'associaient au projet de prendre Tenochtitlan devaient user d'une stratégie faite de tactique prudente, discrète pour prendre une cité que les conditions géographiques rendaient imprenables. Sur des hauteurs montagneuses faisant plus de 2250 mètres, près de la cité, il y avait un grand lac. Cortés vit que par ce lac on pouvait atteindre le coeur de la cité qui avait été fondée en 1325. Mais pour réaliser ce projet, il lui fallait construire une flotte de vaisseaux avec l'aide d'autochtones dissidents. Leur collaboration et leur discrétion étant acquise, ils purent ensemble réaliser ces travaux, et ensuite lancer cette flotte armée au coeur de la ville impériale de Moctezuma II. Malgré une solide résistance de ce dernier, Cortés remporta la bataille et fit détruire la ville en grande partie. La prise de Tenochtitlan, le 13 aout 1521, fut l'événement qui fixa l'installation des Espagnols dans ce grand territoire du Nouveau Monde.
Les sacrifices d'êtres humains
On a bien spéculé sur la chute relativement facile de Moctezuma II. Certains ont dit qu'il a été victime d'une prophétie du précédent empire toltèque qui annonçait que le peuple serait sauvé par des Blancs venus de l'Est. Au courant de cette prophétie, Moctezuma II était d'autant mieux prévenu pour assurer sa protection et garder son peuple à ses côtés. Il avait bien des partisans mais, comme on l'a vu déjà, les dissidents de sa politique étaient si nombreux et déterminés à le voir disparaitre qu'il perdait ses chances de salut personnel. En quelques mots, il faut rappeler les horreurs de sa politique. Entre autres, il prétendait que les dieux de sa religion exigeaient des sacrifices d'êtres humains afin que la nature puisse continuer de donner du fruit, que les astres du jour et de la nuit puissent continuer de donner leur clarté, etc. Par conséquent, il avait établi ou poursuivait une tradition des sacrifices sanglants. On tuait des humains et même on les mangeait. On allait à la chasse à l'homme comme on va à la chasse au cerf. Les Iles Caraïbes en tirent leur nom. Christophe Colomb en avait entendu parler comme des Iles des mangeurs d'homme. On ne mangeait peut-être pas d'hommes sur les Iles, mais elles étaient des territoires de chasse pour les mangeurs d'homme. Moctezuma II avait, en quelque sorte, institué cette pratique. Mais il vint un temps où le peuple en avait assez de ces sacrifices indignes qui pouvaient atteindre 10 000 à 20 000 victimes par année. Le jour où les indigènes apprirent de Cortés qu'il mettrait fin aux sacrifices humains, ce dernier a pu être vu comme le sauveur annoncé. À partir de ce moment, les jours de Moctezuma II étaient comptés.
Ce fait des sacrifices humains reconnu historiquement a eu des précédents en d'autres lieux et à d'autres époques aussi. Cette affaire est assez grave pour s'imposer de l'examiner plus à fond et voir comment on a trouvé une solution dans le passé. On peut remonter jusqu'à Abraham dans la Genèse (22, 1-18) où il est dit que Dieu, pour éprouver Abraham, lui demande d'offrir en sacrifice, son fils unique né de Sara. Les chapitres 17 et 18 de ce livre nous apprennent que Dieu apparaissait à Abraham et lui parlait. Il n'y a pas lieu de s'en surprendre puisque la Vierge de Guadalupe du Mexique tient d'un semblable prodige, n'est-ce pas ? Au chapitre 22, 1, on dit : "Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit : oui je t'écoute. – À 22, 2, Dieu reprit : prends ton fils unique que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là offre-le-moi en sacrifice."
Rien n'indique comment Abraham doit interpréter le sacrifice. Mais parce que Dieu le lui demande, pense-t-il, il doit obéir et agir au mieux de sa connaissance. Les versets 3 et 4 du chapitre 22 de l'édition Tob nous apprennent : "Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui deux de ses jeunes gens, et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu." Quand il reconnut celui-ci, il chargea son fils du bois du sacrifice et prit sur lui d'apporter la pierre à feu et le couteau, tandis que les deux serviteurs restaient en bas à les attendre. Puis (aux versets 7 et 8) en gravissant la montagne, Isaac et son père échangèrent en ces termes : "Voici le feu et les bûches, dit Isaac; où est l'agneau pour l'holocauste ? – Abraham répondit : Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils."
Les versets 9 et 10 nous apprennent que, arrivé au lieu désigné par Dieu, "Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia le fils et le plaça sur les bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils." De toute évidence le texte cité nous indique qu'Abraham a apporté tout le nécessaire pour effectuer un sacrifice humain et perdre ce qu'il avait de plus cher, son propre fils.
Avant d'aller plus loin, on peut supposer que de tels sacrifices se faisaient à l'époque d'Abraham; du moins c'était une possibilité envisagée, d'où l'empressement d'Abraham. D'ailleurs, comment en douter quand on sait que cela se faisait en plusieurs endroits de la planète, jusqu'aux Mayas et Aztèques au XVIe siècle. Quelque trois mille ans après Abraham, on voit Moctezuma II commander des sacrifices humains en faveur des dieux. En pensant répondre à un ordre divin, Abraham accepte d'immoler son fils, tandis que Moctezuma II pense qu'il faut sacrifier des humains aux dieux pour qu'ils continuent d'apporter au monde leurs bienfaits. L'un comme l'autre semble agir en fonction de critères ou d'habitudes culturelles. Spontanément l'un comme l'autre interprète le sacrifice de façon semblable et utilise des moyens comparables pour répondre à un appel. On sait très bien que le dilemme, ou l'épreuve, proposé par Dieu à Abraham, devait causer en lui une angoisse épouvantable, du fait qu'il s'agissait du sacrifice de son fils qu'il aimait tant. Mais les fils sacrifiés sous le règne de Moctezuma II devaient être aussi cause d'angoisse pour les parents et enfants capturés par les Aztèques en vue des sacrifices sanglants, n'est-ce pas ? Construire toutes les hypothèses possibles sur ce qui pouvait différencier les deux hommes ne conduirait probablement pas à une solution satisfaisante.
Tout de même, cela nous place devant une hypothèse rarement examinée : Dieu peut-il nous tromper ou nous éprouver ? Léon Chestov, le philosophe russe chrétien et défenseur de l'individu, a osé poser la question. Je me permets ici de rappeler deux formules bien connues qui vont dans le même sens. Premièrement on dit parfois : Dieu éprouve ceux qu'il aime, voulant signifier qu'il veut tester nos prétendues convictions, notre détermination dans la foi ou la qualité de notre désir. Deuxièmement, les personnes plus âgées ont souvent entendu et utilisé la formule suivante du Notre Père : "ne nous induisez pas en tentation mais délivrez-nous du mal." Il me semble que cette formule est assez suggestive de ce que nous venons de dire dans le contexte du premier ordre donné à Abraham. Autrement dit Dieu peut nous conduire en tentation. À l'occasion du Concile Vatican II, on a crû bon d'adopter une autre formule : "ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal." Cette dernière formule me semble proche parente de l'une des sept paroles de Jésus en croix : "Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? " Cette formule peut tout autant être interprétée comme une sévère épreuve, celle de quelqu'un qui pense que Dieu est loin et qu'il ne vient pas à son aide quand il en a grand besoin. Cette formule se prête mieux au contexte existentiel de notre époque, du moins il me semble. Mais voyons comment la suite du récit peut éclairer notre lanterne.
Revenons au moment où Abraham allait immoler son fils. Au verset 11, on remarque un changement de programme : "Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria : Abraham ! Abraham ! – Il répondit : me voici – Il reprit (verset 12) : N'étends pas la main sur le jeune homme. Ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu, toi qui n'a pas épargné ton fils unique." Dieu voulait-il vérifier si Abraham était capable d'obéissance inconditionnelle ? Les apparences semblent donner raison à cette solution. Par contre, la réponse d'Abraham peut aussi se prêter à l'interprétation qui plaide en faveur de la fragilité et de la faiblesse de l'homme qui ne sait pas encore discerner ce qu'est le Bien Suprême. Il peut facilement être trompé. Il ne questionne ni sa source ni le principe qui le motive. On voit des gens empressés d'obéir aux ordres de chefs et qui se sentent libérés en suivant ceux qui les mènent où ils veulent. Cependant, la crainte de Dieu mentionnée au verset 12 n'a rien à voir avec la soumission aveugle et la peur viscérale des natures vivantes. Elle regarde plutôt le respect dû aux valeurs supérieures ou au principe des valeurs morales essentielles pour vivre dans la vérité et la justice.
En conséquence, l'intervention de l'ange du Seigneur prend ici un sens fondamental en vue de l'apparition d'une nouvelle qualité humaine, ce que certains ont interprété comme un passage à un nouvel état anthropologique. Tout comme si quelque chose changeait dans la formule de l'homme, ou encore cela ressemble à la production d'un éveil provoqué par une impulsion apportée de l'extérieur (transcendante) ou de l'intérieur dans la Racine profonde (immanente) de l'être. Un tel secours de l'ange (allusion à l'ange d'Abraham) facilite la tâche si difficile de rompre avec des habitudes séculaires qui n'ont souvent rien à voir avec la dignité humaine et son essence humano-divine. Je soutiens que le contexte de cette deuxième injonction appartient à la foi véritable parce qu'elle s'inscrit dans le projet de la réalisation humaine intégrale. Ceux qui refusent de franchir ce deuxième palier, qui comprend le désir de croître en humanité, pourront bien invoquer Dieu ou prétendre agir au nom de Dieu, leurs sacrifices extérieurs seront encore sanglants comme on en voit aujourd'hui encore avec les sacrifices rituels d'animaux, prélude aux massacres programmés d'êtres humains. Pour avoir évité de succomber à ce piège en demeurant attentif à la voix qui s'adressait à lui, Abraham a été félicité et béni avec la promesse de grands biens et d'une grande descendance. En plaçant sur l'autel du sacrifice un bélier encorné dans un buisson en substitution de son propre fils, Abraham voulait-il inaugurer les sacrifices d'animaux en pensant qu'ils plairaient à Dieu ? Ce genre de sacrifice a effectivement été poursuivi, mais ils furent fermement contestés par les grands prophètes par la suite. Aussi, Jésus au Temple les a dénoncés comme n'étant pas agréables à Dieu. Jésus, par son propre exemple, a fait la démonstration que l'engagement de la personne au service des autres était le meilleur hommage que l'on puisse rendre à Dieu. Depuis la Nouvelle Alliance, on voit dans la substitution du bélier à Isaac, la préfiguration du sacrifice de l'Agneau de Dieu. Ah ! je vois, disent certains, c'est une vielle histoire déjà toute réglée. Je voudrais bien, mais il n'en est pas toujours ainsi. Moctezuma II, c'était bien quelque trois mille ans après Abraham, quinze cents ans après le Christ. Quel degré de compréhension et d'intégration atteint-on de ces enseignements aujourd'hui ? Il y a des leçons qui s'oublient; puis, il faut recommencer après avoir fait l'expérience de la barbarie. C'est encore d'actualité, n'est-ce pas ?
En guise de conclusion de la première partie
Les Espagnols ont fait la conquête d'un vaste territoire. C'est un exploit. Mais il est autrement compliqué de le maîtriser. Comme disent certains sages : "Prendre le pouvoir est une chose, le conserver en est une autre". De plus, la tentation des conquérants d'abuser des indigènes est bien connue. Dans ce genre de conquête, il ne manque pas de zélés pour détruire les signes encore vivants des traditions locales, surtout quand on invite les légionnaires à le faire. D'autres scribes viennent par après avec la prétention d'écrire "l'histoire du peuple primitif conquis". Il n'y a pas de doute que de telles exactions ont été commises avant le miracle de la Guadalupe. Les missionnaires franciscains les mieux intentionnés n'auraient pu contenir à eux seul les débordements des conquérants n'eut été d'un facteur prodigieux et miraculeux qui changea la donne : l'apparition à un Aztèque d'une Femme qui se présenta comme étant la Mère du Vrai Dieu. En toute évidence, ce fait prodigieux correspond à l'ange du Seigneur qui invitait Abraham à ne pas immoler son fils Isaac.
Ouvrages principaux consultés :
- Père François Brune, La Vierge du Mexique : ou le Miracle le plus spectaculaire de Marie. Préfacé par - Didier Van Cauwelært. Paris, Éditions Le Jardin des Livres, 2002. "
- Les Miracles et les autres Prodiges. Paris, Éditions du Félin, Philippe Lebeau, 2000. 270 pages.
- Bible en version Jérusalem, en Tob, ou en français courant.
En passant par Google, et en écrivant (Vierge du Mexique), on peut déjà découvrir plusieurs images, des vidéos et de bons petits articles, excepté ceux des tricheurs.
Donat Gagnon, Dimanche des Rameaux, 24 mars 2013.
