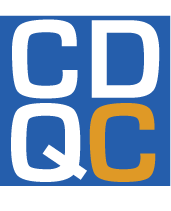
La GRANDEUR DE LA RÉSURRECTION LA VIERGE GUADALUPE EN PAYS MAYA LE SAINT LINCEUL |
||
L’ACCUEIL DE LA RÉSURRECTION
par Donat Gagnon
L’hypothèse de la résurrection
Elle est très ancienne puisqu’on la rencontre chez le Pharaon Akenaton qui serait plus ou moins proche contemporain de Moïse. Dans le Premier Livre des Rois 17. 17-24, Élie ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Également dans le Deuxième Livre des Rois 4. 8-37, le prophète Élisée ressuscite la fille de la Sunamite. Ces deux enfants ne respiraient plus et étaient comptés pour mort. Dans le premier cas, un certain temps avait été nécessaire pour aller chercher Élie dans l’espoir qu’il redonne vie à l’enfant. L’histoire ne dit pas si de tels cas se sont répétés.
Plus tard l’accueil enthousiaste que la foule accorde aux miracles de Jésus donne à penser que quelque chose de nouveau est en train d’arriver, qu’on serait en présence d’un nouveau prophète. On se rappelle peut-être qu’on est dans l’attente de l’ère messianique qui devrait apporter de grands changements facilitant l’existence humaine. Beaucoup de gens souffrent de maladies que les lévites spécialisés en médecine ne comprennent pas. Alors on exclut les malades hors la ville et on les traite de lépreux impurs. Il se trouve que Jésus s’intéresse à ces gens malades dans leur corps ou dans leur psychisme pour ceux qu’on dit possédés d’une puissance qui s’empare d’eux. Les guérir comme il le fait n’est en rien comparable à quelqu’un qui se donne en spectacle. Habituellement les prestidigitateurs font leur métier avec les gens bien portants qui sont capables de payer leur billet d’entrée.
Chaque guérison de ce Jésus semble être effectuée par esprit de compassion envers quelque aspect de la misère humaine. Mais ces gestes de bonté ou de miséricorde soulèvent l’adversité des personnes responsables des affaires sacrales de la cité. Car le thaumaturge semble détenir des pouvoirs qu’ils n’ont plus. Cela les dérange considérablement d’autant plus que Jésus profite de l’occasion de tels prodiges pour rappeler et éclairer certains passages de la tradition religieuse dans laquelle il est inscrit et formé. Il a l’allure d’un sage véritable qui est capable de prouver ce qu’il affirme et de démontrer la pertinence des énoncés du texte sacré. Cela dérange beaucoup les docteurs de la loi et les lévites dont l’incompétence est montrée du doigt par les femmes et les hommes qui le suivent.
Jésus renouvèle la pratique d’Élie et d’Élisée
Pour faire un lien avec le premier paragraphe qui présente deux cas de résurrection, on va cette fois consulter Marc 5, 35-43, qui rapporte que des messagers arrivent de la maison de Jaïre pour lui dire qu’il n’avait pas besoin de déranger le Maitre puisque sa fille était déjà morte. Sans tenir compte de leurs paroles, Jésus dit au chef de la synagogue : « Sois sans crainte, crois seulement. » Et Marc rapporte encore qu’il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean. Mais pourquoi ? Arrivé à la maison, il voit des gens qui pleurent et qui crient. Il leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte, elle dort. » Il jette tout le monde dehors sauf le père et la mère et les trois apôtres mentionnés. Il prend la fillette par la main, et lui dit : « Fillette, debout je te le dis ! » La fillette de 12 ans se leva aussitôt et se mit à marcher. Jésus leur dit : « Donnez-lui à manger. » Preuve que c’était une résurrection dans le monde visible concret.
Le « crois seulement ! » de Jésus adressé au père souligne déjà l’importance de la foi pour opérer ce genre de miracle. Mais Jésus semble tenir aussi à ce que quelques témoins croyants y participent. D’ailleurs une autre fois lors de la transfiguration sur la montagne les trois mêmes apôtres assistaient à la transfiguration de Jésus en compagnie des prophètes Elie et Moïse décédés depuis des siècles. Jésus n’opère pas semble-t-il sans la présence de quelques croyants.
On pourrait spéculer sur la fillette qui s’est relevée aussitôt. Certains diraient qu’elle n’était que dans un coma léger et qu’une intonation de voix particulière suffisait pour l’en sortir, etcétéra… Mais ceux qui font ce genre de remarque ne font pas de miracle de résurrection.
Je présume que les lecteurs se rendent compte qu’on est en train de chercher une définition pour la résurrection. Dans le cas de la fille de Jaïre, Jésus lui commande de se lever. Puis, comme il avait dit qu’elle dormait, il pouvait tout aussi bien lui dire de se réveiller. Se relever, sortir d’un état de sommeil c’est tout un. C’est le sens premier généralement reconnu pour la résurrection. Mais il est susceptible de transposition à d’autres niveaux de l’être. Car la résurrection est aussi passage par une porte ouverte sur la Vie en abondance, une vie qui débute ici et maintenant et ne connait pas de fin. Se relever est souvent employé aussi par les gens qui ont vécu une dure épreuve et qui ont dû se relever pour reprendre gout à la vie. Il y a des angoisses qui sont comme des morts dont on se relève à l’instar d’une résurrection. Ensuite la vie reprend son cours et la joie est au rendez-vous.
En Luc 7. 12-16, on transporte un mort dans son cercueil; c’est le fils unique d’une veuve qui perd tout avec son fils. La femme sans homme au foyer et sans droit d’héritage, est jetée dans la misère sociale. Jésus prend pitié, touche au cercueil et commande au mort ceci : « Jeune homme, je te l’ordonne, réveille-toi ! » Alors le mort s’assit et se mit à parler, rapporte Luc. On acclame Jésus en grand prophète. Comme Élie et Élisée, il apporte le secours à une mère qui retrouve sa mission et son bien.
La résurrection de Lazare
Le miracle de la résurrection de Lazare rapporté par Jean 11. 1-55, est le plus vibrant de tous. Ce récit est décrit avec finesse et détail. Jésus s’était réfugié de l’autre côté du Jourdain à l’endroit où Jean le Baptiste opérait des baptêmes de conversion par l’immersion. On vient prévenir Jésus que Lazare le frère de Marthe et Marie de Béthanie, est très malade. On lui suggère de se presser puisqu’il est certain qu’il va mourir. Mais Jésus ne se presse pas; il retarde son départ de deux jours. Puis il dit : « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir; elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester la gloire du Fils de Dieu. » Avant de faire le voyage, il dit aux disciples : « Notre ami Lazare s’est endormi, mais je vais aller le réveiller ! » À quoi les disciples répondirent donc : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Cette fois ceux-ci interprétèrent la mort probable de Lazare comme l’assoupissement du sommeil.
À l’approche de Béthanie, il voit Marthe venir à sa rencontre; celle-ci lui apprend que son frère était mort depuis quatre jours, et que si Jésus avait été là à temps il serait encore vivant. Mais la confiance de Marthe est telle qu’elle croit que Jésus peut encore faire quelque chose. Il n’y a pas de doute que Lazare est vraiment mort. Mais il veut faire franchir une nouvelle étape à la compréhension de la mort et du processus de la résurrection. C’est comme s’il voulait utiliser le cas extrême de Lazare vraiment mort pour bouleverser l’opinion qu’on se faisait déjà des cas antérieurs. Ils dormaient simplement. Au contraire, Jésus veut saisir la foule de la réalité de la mort par un mort qui sent déjà après quatre jours au tombeau. Il veut exécuter la preuve d’une promesse de résurrection : « Même mort si vous croyez dans le Fils de l’Homme vous vivrez. »
Jean rapporte que le mort est bien sorti du tombeau et qu’il a vécu encore plusieurs années en compagnie de ses sœurs. Dans l’interprétation de cet évènement, il y en a qui prétendent que ce n’était pas une vraie résurrection puisqu’il a continué à vivre sur le même plan parmi les siens et qu’il lui fallut mourir encore. Ceux qui interprètent de cette façon ont une idée arrêtée sur un aspect de la résurrection, fût-ce le plus important. Ce dernier n’autorise pas nécessairement l’annulation des résurrections plus relatives dans le genre de celles que nous avons relevées. Ces dernières ont été accomplies par de grands prophètes; par ailleurs Jésus ressuscité a permis que ses disciples en accomplissent. Plus précisément, les épitres de Pierre et Paul rapportent qu’ils en ont opérée respectivement au moins une.
Personnellement, je trouve que le texte de la résurrection de Lazare est parmi les plus sublimes. Ce texte confirme que les vérités les plus fondamentales dérangent les idées mondaines reçues. Ensuite les gens bien installés et en situation d’autorité n’aiment pas être dérangés par quelqu’un qui peut ébranler leur pouvoir. Pour preuve, Caïphe le Grand Prêtre dit : « Vous ne comprenez rien et vous ne percevez même pas que c’est votre avantage qu’un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » (Jean 11. 49-50) Cette phrase exprimait déjà l’intention du Sanhédrin d’arrêter Jésus. Mais le plus profond réside dans ce qui me parait être le « mécanisme » de la résurrection. L’éclairage apporté par Jean peut même servir à rassembler tous les cas précédents mentionnés. À plusieurs reprises le chapitre 11 rappelle combien les sœurs de Lazare aimaient leur frère et combien aussi Jésus l’aimait au point de pleurer; ce qui amena plusieurs à dire : « Voyez comme il l’aimait ! » Tandis que quelques-uns du groupe avaient une réaction de sceptique : « Celui qui a ouvert les yeux de l’aveugle n’a pas été capable d’empêcher Lazare de mourir. » C’est toute la question de la mémoire et du rappel qui est en cause.
Précisons. De qui se rappelle-t-on le plus ? Se rappelle-t-on des gens qu’on rencontre en toute indifférence ? Non, ils sont comme des ombres fuyantes. Par contre, nous nous rappelons très bien des gens que nous avons vraiment connus et réellement aimés. C’est cela qui est mis en évidence dans l’exercice du rappel très concret de la résurrection de Lazare. Ce dernier est rappelé à la vie par ceux qui l’aimaient, à l’instar d’un fait intéressant qui revient sur l’écran de la mémoire. Cet amour non indifférent est doué d’efficacité, est efficient sur des plans plus subtils de l’être. Dieu se rappelle, il a le pouvoir de ressusciter qui il veut. En somme, ces observations valent pour tous les cas examinés précédemment. Le fils de la veuve de Sarepta et la fille de la Sunamite reprennent vie parce que ces deux mères aimaient profondément leur enfant et avaient une foi sans réserve à l’endroit des deux prophètes Élie et Élisée. Ceux-ci touchés par la sincérité de ces deux mères ont appliqué le « mécanisme » du rappel, ou du réveil, ou de la régénérescence qui a permis à ces enfants de se relever en pleine santé et en pleine conscience. Le cas de la fille de Jaïre est tout aussi émouvant. Jaïre qui accourut vers Jésus pour demander de sauver sa fille prouve déjà qu’il l’aimait. Jésus lui demande en plus d’avoir foi. Arrivé à la maison de Jaïre, Jésus veut voir dans la place le couple de parents qui aiment leur enfant ainsi que les trois apôtres qui sont dans les bonnes dispositions d’un amour sincère, des conditions qui s’accordent avec le « mécanisme » du rappel.
Difficultés de l’accueil de l’essentiel
Ces trois témoins de la transfiguration du Tabor avaient pu constater que le Maitre était capable de donner une vie nouvelle aux paroles des grands prophètes et de s’impliquer dans le grand débat qui opposait saducéens et pharisiens sur la résurrection. On rapporte que les premiers ne croyaient pas en la résurrection et qu’il suffisait de régler les problèmes de la condition terrestre; tandis que les pharisiens se montraient ouverts à la perspective de la résurrection. Les points qui les opposaient sont sensiblement les mêmes aujourd’hui entre les tenants d’un humanisme sociologique et ceux qui se disent intéressés à grandir dans la survie post mortem. Quand Nicodème visita Jésus de nuit en secret était-il sincère ou espion du Sanhédrin ? Était-il pharisien ? Ce n’est pas certain. Il savait bien féliciter Jésus pour les signes qu’il faisait et qui témoignaient de son origine d’en haut. Mais il était incapable de comprendre ce que signifie naitre d’en haut. C’est pourquoi Jésus lui répond avec insistance en Jean 3.1 : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naitre d’en haut, nul ne peut voir le Royaume de Dieu. » Son incompréhension de ce que signifie naitre de l’Esprit donne à penser que sa foi en la résurrection était faible. Tant qu’on n’a pas franchi cette brèche, on donne l’avantage du terrain au « saducéen » avec sa conception horizontale de sceptique résolu et content.
Le texte sacré que l’élite se donnait l’air de connaitre était devenu un instrument de contrôle du peuple. Avec Jésus toute parole de la tradition mosaïque reprenait vie à l’occasion d’un énoncé verbal, d’une guérison, d’une transmutation prodigieuse et d’autant plus la résurrection de Lazare. Les faits produits par Jésus étaient chaque fois une confirmation d’un enseignement déjà inscrit dans le texte sacré. Ce n’était pas le pouvoir qui motivait l’intervention de Jésus mais l’esprit de compassion, d’amour, de miséricorde envers les personnes qui reconnaissaient leur manque et leur désir profond de libération et de réalisation. Ceux qui prétendraient arriver aux mêmes résultats sans ces vertus ontologiques arriveraient à imiter jusqu’à un certain point le phénomène extérieur mais pas la vertu du miracle qui implique une transformation radicale par grâce. Dans cet ordre de chose, l’épreuve de transformation importe plus que la preuve matérielle, et le signe vaut pour celui qui y est ouvert.
Symbole et symbolisme
La nature est signe quand le créateur est reconnu. Quant au symbole, il est un pont entre le visible et l’invisible, un accès entre un certain niveau concret et un abstrait qui se révèle dans la Présence existentielle. Jésus savait tout cela car les textes répètent qu’il priait, qu’il posait des gestes de miséricorde. Sa transfiguration parmi Hélie et Moïse, en présence de trois apôtres, témoignent en faveur de son être « multidimensionnel. » Son incarnation et sa mort acceptées sont des marques de confiance filiale envers son Père qui saura bien « rebâtir le temple en trois jours. » L’aide du Père pour opérer la Résurrection du Fils, est à mettre en corrélation avec l’abaissement extrême de l’Incarnation du Fils. Ce dernier doit être élevé de terre pour que les disciples qui suivront soient également élevés par l’attraction de l’Amour inconditionnel. Par sa passion et sa mort horrible, il épousait le passage obligé de chaque être humain dans l’autre dimension. Sa mort est un mystère de proximité « en tous » vécu dans la douleur et même la tentation du sentiment d’être abandonné. Son exemple éclaire la misère possible de chacun en même temps que la promesse d’un accompagnement providentiel. Les trois Thérèse (s) d’Avila en Espagne, de Lisieux en France et Thérèse Newman de Konnersreuth en Allemagne, et plus récemment Marthe Robin en France ont compris et exprimé dans leur chair la signification de la Croix de Jésus Christ comme le signe salvateur de l’accompagnement de chacun en voie de naitre au Ciel. Ainsi le mystère de la mort s’éclaire par le passage à la Vie éternelle dans le Royaume préparé. La douleur du détachement d’une vie limitée s’efface devant la grandeur de l’Infini divin. En somme, l’on peut dire que Jésus Christ est le Grand Symbole puisqu’il est le pont qui relie tous les ports d’arrêt de son parcourt de l’Alpha à l’Oméga. Ainsi, nous avons illustré le sens plénier de la définition du symbole donné en deuxième phrase de ce paragraphe. Le Crédo, appelé symbole de Nicée ou symbole des apôtres, l’affirme également. Dans ce cas précis de la Résurrection de Jésus Christ, je concèderais que le Symbole et le Symbolisé coïncident.
Le langage de l’image pour s’approcher du mystère
Maintenant, parlons le langage de l’image, celui des textes relatifs à la crucifixion, à l’ensevelissement, à la période au tombeau et à ce qui suivit, un peu à la manière du cinéma qui a participé à notre instruction. Les signes dans le ciel, les tremblements de terre, les morts qui ressuscitent signalent que le monde est en train de changer et que même les Enfers peuvent se vider. Car Jésus y est descendu selon Jean et le rappel du Crédo. Cet évènement aussi réel que symbolique est encore la signature d’un être « multidimensionnel » qui rappelle à l’Éveil et à la Vie ceux qui y séjournaient.
Le tombeau vide au matin de Pâques n’est pas vide de sens. Au contraire les linges de l’ensevelissement, laissés là, vidés du corps qu’ils contenaient et signés des empreintes des coups qu’on lui avait fait subir, signifient que le tombeau n’était pas le séjour d’un tel Roi, que sa miséricorde devait aussi s’exercer dans le séjour des états inférieurs et que la miséricorde du Père dans l’Esprit pouvait l’en faire remonter.
Au matin de Pâques, alors que Marie-Madeleine (ou de Béthanie ?) veut l’approcher d’un peu trop près, Jésus la prévient de ne pas le toucher car il n’a pas terminé sa remontée vers le Père. Là-dedans il y a un enseignement pour nous qui voulons parfois retenir les mourants par le trop d’émotions.
Le fait qu’elle l’ait pris pour le jardinier montre qu’elle ne l’a pas reconnu immédiatement, mais ce fait s’accorde bien avec l’état transformé d’un ressuscité. D’abord pouvait-elle s’attendre de faire une telle rencontre ? Ensuite qu’est-ce qui justifierait que le mort ressuscité prenne absolument les mêmes caractères corporels ? Ce corps était-il le même ou un autre pour que Marie-Madeleine, les autres disciples d’Emaus et plusieurs autres ne le reconnaissent pas d’emblée ? On lit ou on se rappelle que Jésus a montré les marques de ses plaies pour aider ses amis et ses frères à le reconnaitre. Thomas qui n’était pas avec eux avait besoin de constater par la vue et le toucher les plaies de ce revenant. Il n’était pas plus bête que les autres qui avaient perdu la foi dans le cours de la passion. Il me semble y avoir là un enseignement qui complète la signification de la croix salvatrice. L’invitation de Jésus Christ à Thomas de mettre son doigt dans les trous des clous et dans son côté, veut probablement signifier l’accueil des doutes de Thomas et le transfert du poids de ses inquiétudes sur Jésus ressuscité capable de les assumer. La réponse de Thomas ne se fit pas attendre : « Mon sauveur et mon Dieu. » Il a compris que l’association à la Croix du Christ était la Voie de Salut, tel que l’ont compris les Thérèse (s) et Marthe mentionnées plus haut. De plus, l’être qu’il touchait n’était pas un fantôme ni un abstraction; il était on ne peut plus réel.
Il y a là le fait d’un être dont le corps a été transformé par le pouvoir de la résurrection en Esprit et en Vérité. Le corps de cet Être peut se manifester dans des modalités diverses, au séjour des morts, parmi les disciples, quand il passe au travers les murs, de l’invisible au visible et vice versa, et en hauteur à l’Ascension. Ce Jésus ressuscité mange du poisson en compagnie des disciples au bord du lac Tibériade. Il a donc la capacité de se montrer concrètement et même (détail oblige) habillé comme il le veut; de devenir translucide ou d’apparaitre dans un halo de lumière.
Évidemment cela est incompréhensible pour ceux dont les sens sont déjà sclérosés par la gravitation mondaine. Pourtant la perception des modalités du corps de résurrection devient plausible dans la mesure même où les sens sont spiritualisés au contact de l’Être du Royaume annoncé et toujours proche. N’est-il pas dit qu’on pourrait, qu’on devrait arriver à voir les êtres comme Dieu voit ? Cette invitation est lancée dans les évangiles où Jésus suggère de le voir ou de le reconnaitre dans les autres; de même dans les tout petits, c’est-à-dire ceux qui ont soif de vérité et d’amour, peu importe leur condition sociale. De même dans la prière qu’il nous a laissée, il nous invite à pratiquer la miséricorde qui est une vertu ontologique, aussi à être parfait comme le Père céleste est parfait, non à la manière du monde qui tape sur les doigts lorsqu’une erreur est commise mais en ayant une attitude miséricordieuse dans l’approche d’autrui, en pratiquant un « entendement » sincère et intime dans la relation à autrui. Aujourd’hui, on dit avoir une « bonne écoute » de l’autre. On peut faire le rapprochement entre l’ouïe, l’écoute et l’entendement qui est l’attitude cordiale intelligente. Se faire proche de l’autre est une sorte de « toucher » spécifique du mode concret. Se rendre capable de « sentir » autrui qui veut dire l’accepter et par conséquent l’inclure plutôt que l’exclure. Finalement de prendre « gout », de gouter vraiment le fruit de l’Esprit comme le Créateur au Matin du monde devant le spectacle des êtres sortant de la Source originelle : « Et Dieu vit que cela était « bon » ou « beau » selon que les traducteurs mettent l’accent sur le bon gout ou sur la satisfaction de l’artiste devant l’œuvre accomplie. Bien sûr ces formules d’émerveillement valent aussi pour tous ceux et celles qui participent à l’œuvre créatrice.
Les sens sont des réalités du corps de chair mais on remarque qu’ils sont transposables sur le corps de résurrection du plan spirituel, et ultimement du corps de gloire. C’est ainsi que les sens du corps de chair servent de support symbolique dans l’approche d’une Réalité qui les dépasse. Les symboles qui se retrouvent dans les formes diverses d’expression artistique peuvent contribuer à la concentration et au développement de l’aspiration spirituelle en ouvrant des brèches sur les états transcendants du sentiment, de la perception et du désir. Le langage est symbolique mais le symbolisé est réalité. Le langage symbolique d’un matérialiste n’a pour seul référent que le monde des évidences sensibles enfermées dans l’horizontalité, en raison du choix, dirions-nous, de prendre la partie pour le Tout. Tandis que le métaphysicien traditionnel manie plutôt un symbolisme hiérarchique où tous les échelons participent de la Réalité. Dans un tel cas, un symbole à notre portée est symbole dans la mesure même où l’on envisage que la « réalité une » englobe les plans distincts qui la manifestent à divers degrés, d’où le caractère hiérarchique de ce symbolisme. Une telle façon de voir permet de faire entrer dans le « concept » de réalité les divers types et niveaux d’expérience des uns et des autres y compris celles des mystiques, des expériences aux frontières de la mort, des témoins de l’invisible tel saint Paul, et bien sûr les manifestations de Jésus Christ ressuscité, qui défient la vision ordinaire. Les nombreux témoins du monde spirituel, ce dernier étant autre chose que la simple activité mentale, forcent la révision de l’idée qu’on se fait de la réalité intégrale. Et je crois que Jésus Christ a fait l’impossible pour nous la révéler. Il reste à nous de la considérer pour notre salut et notre réalisation intégrale.
Prendre garde aux ambigüités possibles dans le maniement des symboles
Quelques théories du symbolisme voient le monde sensible comme pôle de la réalité, d’autres s’appuient sur le monde psychique. Le passage d’un monde à l’autre suggère déjà un déplacement du pôle de la réalité. En poussant plus loin encore, on verrait que le pôle de la réalité, qui est l’autre façon de nommer le « symbolisé », s’inverse complètement par rapport à la vision ordinaire du monde sensible. Si on prend l’exemple bien connu du soleil. Le mot qui le nomme est le signe de la réalité sensible du soleil. Par contre le soleil du plan sensible peut lui-même être symbole d’une « réalité supra sensible. » Cela fait que l’application du symbolisme s’inverse selon qu’on a en vue, soit le monde sensible, soit le monde supra sensible. Ce genre d’inversion et le maintien de la distinction des plans de réalité permettent d’éviter des confusions encore bien fréquentes chez les auteurs. Par ailleurs, ce qui pourrait sembler être une concession aux circonstances et aux vécus des uns n’est pourtant pas une entrave aux plus grandes aspirations des autres. De plus, ce genre de tolérance permet d’éviter les diverses formes de radicalisme destructeur.
Les symboles qui sont utilisés pour initier à la foi sont importants puisqu’ils sont des ponts pour faire assentir une réalité plus subtile qui est de l’ordre du cœur ou du centre. Rappelons encore que les symboles sont des médiations qui prennent la plénitude de leur sens quand la Réalité est là. Les apôtres et autres disciples avaient reçu du Maitre un enseignement riche de signification ou de grande valeur symbolique. Tout ou presque avait été prononcé. Mais ils ne comprenaient pas vraiment toute la portée de cet enseignement tant qu’ils ne fussent mis en face de la Réalité suressentielle du corps de résurrection. Peut-être en va-t-il de même pour nous ? Tant que le texte sacré n’est pas devenu parole au cœur, la signification des symboles et des paraboles échappent au lecteur. Tant que la foi n’est pas née, la tentation est grande de faire de la réalité suressentielle une réalité moindre que celle des évidences mondaines. Quand on a la foi, plein de signes parlent au cœur et rappellent le vécu existentiel. La foi au cœur du croyant est déjà l’effet d’un vécu, d’un ressenti sur un plan subtil. Certains en parlent en terme de rencontre, d’un toucher dans l’âme qui a transformé l’attitude et le comportement. Pour une telle personne, les signes et les paroles de Jésus deviennent des confirmations de la valeur des vécus personnels.
Les témoins du spirituel aujourd’hui
Oui, les signes ne manquent pas aujourd’hui autant qu’hier. Les expériences aux frontières de la mort répertoriées dans de nombreux ouvrages actuels de spiritualité et aussi chez de nombreux scientifiques qui ont accepté de se mettre à l’écoute des milliers… de témoins de l’invisibles, de ces « expériencieurs » de l’autre dimension qui ont eu le privilège de vivre une expérience suressentielle, de la vivre à l’occasion d’un accident très grave, ou, alors qu’ils étaient laissés pour mort dans un hôpital, d’être témoin conscient d’un personnel médical affairé à réchapper leur corps blessé grièvement et témoin simultanément d’une dimension de gloire associable à un état de l’Esprit qui leur fait se demander s’ils sont dans leur corps ou dans un autre alors même qu’ils sont distants de celui que les toubibs s’efforcent de réanimer. Cela rappelle, avec le côté médical en moins, une expérience que saint Paul dit avoir vécue.
Les gens qui vivent ces expériences ne sont pas toujours des accidentés; saint Paul ne l’était pas. Beaucoup de mystiques ont vécu des expériences analogues sans avoir été des accidentés. La qualité des prodiges et des miracles qui se produisent en leur présence, de leur vivant ou après leur décès, témoigne de leur relation spirituelle. Le concept de paranormal souvent utilisé ne suffit pas pour rendre justice à de tels témoins de l’invisible.
Parfois il se trouve quelque sceptique pour affirmer que tous ces gens doivent être dérangés dans la tête… Et puis après !? Ne vaut-il pas mieux que l’égo soit dérangé, si ce dérangement ouvre les portes de la dimension invisible qui donne accès à la surconscience, à une qualité d’intelligence et de mémoire qui fait réaliser l’indigence de nos moyens actuels rendus ordinaires par la gravitation mondaine des modes.
Un tel sentiment d’éternité vécu dans l’ « Instant kierkegaardien », contre toute attente, commande le vivre dans l’enthousiasme avec les autres, au service d’autrui comme une responsabilité acceptée et le témoignage d’une régénération de la personne. C’est cela le royaume commencé ici et maintenant. Peu importe l’absurde de la situation dans laquelle on opère, on agit quand même porté par l’Étoile. C’est cela l’esprit kierkegaardien repris par Denis de Rougemont et la plupart des personnalistes chrétiens.
Les théologiens en désaccord
Il semble que les philosophes ne soient pas les seuls à se contredire les uns les autres en raison d’options idéologiques différentes. Le monde apparemment harmonieux des scientifiques vit d’étranges tiraillements derrière les portes closes des comités scientifiques. Quelquefois leurs inventions pourtant sanctionnées par convention sont contredites par les méfaits qu’elles produisent dans leur application. On s’en tire avec un calembour toujours à la mode : c’est l’évolution ! Quant aux théologiens, ils travaillent à partir d’ouvrages communs consacrés malgré l’usure du temps. La règle habituelle demandée est d’avoir foi dans la vérité du message. Par conséquent, on s’attend à une certaine harmonie dans l’arrangement des tons. Mais ce n’est pas si simple.
Les textes des livres saints ont été rédigés sur d’assez longues périodes temporelles. La plupart des genres littéraires sont représentés dans les livres qui composent la Bible. Ils ont été écrits dans des langues anciennes : hébreu, araméen, grec, latin, copte, syriaque, slavon, cyrillique, ainsi que les nombreuses traductions et adaptations. Chaque groupe linguistique et chaque école d’interprétation peuvent être tenté de veiller au maintien de leur modèle culturel respectif avec la rigueur nécessaire pour assurer la continuité. Par contre, on ne peut pas toujours échapper aux bouleversements culturels. Par exemple, le simple fait que les mots changent de sens en les adaptant aux transformations linguistiques. C’est déjà un problème pour retrouver la juste interprétation. C’en est un autre de contraindre tout le monde à respecter la formulation originelle. On peut voir là une mine de conflits possibles à éviter. Je relèverai seulement deux groupes que j’ai pu observer dans leur façon de traiter le Nouveau Testament.
Il y a quatre évangiles canoniques qui se distinguent en synoptiques : Matthieu, Marc, Luc; et en sacerdotal, celui de Jean. D’après certains analystes et exégètes, ces évangiles peuvent faire contradiction. Le groupe des synoptiques soutient que la perspective des trois auteurs est celle du Jésus historique, tandis que l’évangile de Jean plus tardif en fait peu cas, disent-ils; mais ce dernier insiste davantage sur les moyens à mettre en œuvre pour arriver à Dieu.
Je trouve tout à fait recevable le fait que trois évangiles soulignent le passage historique de Jésus, de l’annonce de sa naissance à sa vie publique, de sa passion, de sa mort jusqu’à sa résurrection et même de son ascension spécialement soulignée aussi par Luc et Marc. Même si ces textes n’ont pas tout ce qu’on s’attend d’une biographie moderne, il faut reconnaitre qu’ils sont porteurs de résonnances suffisantes pour transmettre le message d’un homme le plus connu et probablement le plus aimé de la planète.
Quant à l’évangile de Jean qui débute avec le baptême de Jésus par le Baptiste, il donne moins d’espace à la biographie de Jésus. Par contre il souligne fortement le caractère initiatique de cet évangile en s’ouvrant sur un baptême, en poursuivant sur le choix des apôtres qu’il va initier pour s’en faire des disciples privilégiés qu’il guidera même après sa résurrection. Il est vrai que l’évangile de Jean est de facture sacerdotale. D’ailleurs, le Jésus de Jean-Christian Petitfils (Arthème Fayard, 2011) nous informe que le Baptiste lui-même était de la caste sacerdotale. Cela ne fait pas du Baptiste l’auteur du quatrième évangile, bien sûr, mais cet évangile serait de la lignée. Il est clair que l’enseignement de Jésus aux apôtres est plus élaboré, plus complet sans doute en vue de la mission qu’il disait avoir reçue du Père et qui devait se continuer après son départ de la vie terrestre. Jean-Christian Petitfils est un historien très au courant des études archéologiques et bibliques. Il démontre avec une compétence remarquable que les lieux et les personnes nommés dans le quatrième évangile sont en parfaite conformité des recherches effectuées sur le terrain et rapportées par les historiens. Par conséquent, on ne peut pas faire de cet évangile celui qui parlerait d’un Jésus mythique qui pourrait ne pas avoir existé sur terre. Bien au contraire, en s’inscrivant dans l’histoire comme les synoptiques, il complète ceux-ci en soulignant que le royaume qu’il propose ne se limite pas aux conditions de l’histoire. Sa vision du Royaume est à l’image du Jésus humain, mort et ressuscité, et divinement ascensionné et glorieux, donc à ciel ouvert. La tentative de soulever le voile des apparences en vue des destinées plus élevées n’enlève rien aux enseignements qui visent à soutenir les étapes du cheminement de chacun. Ce point de vue est proche parent de celui de saint Paul qui a fait la connaissance de Jésus Christ mort et ressuscité. L’évangéliste Jean comme saint Paul devaient savoir que Jésus avait vécu sur terre et que son message concernait aussi l’Au-delà de la vie terrestre. Les deux auteurs sont les plus proches de ce que rapportent les témoins de l’invisible aujourd’hui. La manière dont nous les accueillons est à la mesure de notre niveau d’aspiration spirituelle.
Accorder la diversité des humains et des vécus existentiels
Ceux du groupe des synoptiques préfèrent le Jésus près de l’histoire qui interpelle les acteurs de son temps sur terre pour redresser leurs tares, aider la condition féminine, favoriser une société plus humaine et plus juste pour tous. On en tire un programme sociologique intéressant, mais il court le risque d’être enfermé dans les limites de l’histoire. Chez ce groupe la tentation est grande de faire de Jésus un messager de réponses circonstanciées à son époque, laissant entendre que s’il revenait aujourd’hui il devrait changer son message sur certains points. Ainsi, on recourt à « l’ évolution » pour accorder un Jésus renouvelé et adapté aux modes actuelles.
D’un autre côté, si le groupe de Jean plus favorable au transhistorique allait jusqu’à dire que Jésus n’avait pas besoin de venir sur terre et qu’après tout son personnage est un mythe riche de signification pour l’homme en voie de divinisation. Beau programme. Mais celui-ci a le défaut de bousiller l’Incarnation et la Rédemption apportées par Jésus. Je prends pour témoin le saint Linceul conservé à Turin et sur lequel Jésus crucifié nous a laissé les marques qu’on lui a infligées pour bien nous rappeler son passage sur terre et l’aide providentielle que la croix du salut peut nous apporter. Son incarnation humaine a rendu possible l’engagement chrétien. Les reproches souvent adressés aux chrétiens sont comme l’arbre qui cache la forêt. C’est tenter de cacher le grand rôle joué par ceux-ci dans la formation du sens de l’humanité et de la transcendance. Que serait devenu le monde sans l’engagement chrétien, sans le message de la résurrection qui concerne aussi chacun d’entre nous, et sans la vision de la liberté spirituelle qui a fait sauter les verrous de bien des prisons.
On rencontre encore bien d’autres contradictions entre théologiens. Les uns et les autres apportent leur éclairage qui peut être utile à notre maturation spirituelle. Finalement, les contradictions des évangiles ne sont apparentes qu’à ceux qui s’enferment dans quelques passages du livre pour en tirer une théorie à leur convenance. Les apparentes contradictions s’accordent avec la diversité des humains et des vécus existentiels. La parole « unifiée » serait plus dommageable.
En somme, tous les exemples et sens que nous avons relevés à propos de la résurrection, sont les points forts de l’aventure humaine en marche vers quel Éveil et Dépassement. Ce sont des raisons d’espérer et d’accueillir ce qui est au-delà de toute attente.
©DonatGagnon Avril 2015
LA PARABOLE DU FILS PRODIGUE MÉDITÉE PAR HENRY NOUWEN ET REMBRANDT.
Par Donat Gagnon
Henry Nouwen écrit : « La question ouverte, posée dans la parabole de l’enfant prodigue et reprise dans le tableau de Rembrandt, m’invite à une longue quête spirituelle. Quand je regarde la figure éclairée du fils ainé, et quand je vois ses mains dans l’ombre, je sens non seulement sa captivité, mais aussi la possibilité de libération. Cette parabole ne sépare pas les deux frères comme le bon et le mauvais. Seul le père est bon. Il aime ses deux fils. Il court à la rencontre des deux. Il veut que les deux s’assoient à sa table et participent à sa joie. Le plus jeune se laisse embrasser dans une étreinte miséricordieuse. Le fils ainé se tient à distance, regarde le geste de miséricorde de son père, mais ne peut pas encore surmonter sa colère et laisser son père le guérir, lui aussi. » (Le retour du fils prodigue, Par Henry Nouwen, Traduit de l’anglais par Rollande Bastien. Montréal, Bellarmin 1995, page 98)
 |
Cette huile exécutée par le peintre Régent Ladouceur, à gauche est une réplique du célèbre tableau de Rembrandt conservé au musée de l’Hermitage de Saint-Pétersbourg (Russie) |
Préambule
J’ai choisi la citation en exergue pour placer le lecteur dans le vif du sujet d’un article que j’ai publié en 1998. Il est question de l’Enfant prodigue de l’Évangile de Luc, médité par Henry Nouwen qui fut professeur à Harvard et par Rembrandt (1607-1669) le peintre hollandais bien connu pour sa technique remarquable du clair-obscur.
Cette citation comme le texte qui suit tombe à point nommé dans l’année pastorale de la Miséricorde divine proposée par le Pape François qui a publié récemment un livre sur ce thème.
La parabole de l’Enfant prodigue est la plus longue des évangiles. Luc a dû y mettre le plus grand soin pour faire en sorte qu’on s’y arrête avec la plus grande attention. Car, en fait, la Miséricorde est parmi les attributs les plus importants du Père. À ce titre la miséricorde peut sembler être éloignée de nous. Et pourtant, nous devrions nous sentir concernés puisque nous sommes conviés à pratiquer cette très grande vertu, sans doute associée à l’invitation de l’évangile de Jésus qui affirme : « Soyez parfait comme le Père céleste est parfait »
La parabole de l’Enfant prodigue
Qui n’a pas lu ou entendu cette parabole rapportée par Luc 15 :11-32 ? Peut-être même ce récit a laissé sur vous une forte impression. Car nous sommes toujours le fils ou la fille de nos parents qui avons connu un moment le désir de s’éloigner parfois en clamant notre révolte et en osant jusqu’à réclamer ce qu’on croyait être notre dû. Mais si, au contraire, on était le gentil garçon ou la fille fière et à sa place, on a pu penser que cette histoire symbolique ne nous concernait pas. Ainsi le pensait Henri Nouwen, l’auteur d’un livre publié en 1995 et intitulé Le retour de l’enfant prodigue. Le cheminement qui a amené l’auteur à écrire ce livre est révélateur de la profondeur du récit rapporté dans «L’évangile de Luc 15 : 11-32». C’est en 1983 à la suite d’une session de cours et de conférences harassantes que notre auteur se retrouve à Trosly, la tête d’un réseau de 90 communautés de l’Arche, fondé par le canadien Jean Vanier. À l’époque, il avait aperçu sur une porte la reproduction d’un détail d’une peinture de Rembrandt intitulée Le fils prodigue. Sur le coup, il est saisi par la puissance de l’image, qui lui rappelle d’ailleurs son état de fatigue et son besoin d’être consolé par des mains tendres et fortes, comparables à celles de ce « père » du tableau.
Une amie lui apprend qu’il existe aussi en vente une reproduction de l’ensemble du tableau dont l’original est au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Les circonstances font que notre auteur se rend au dit-musée pour contempler cette œuvre d’un des plus grands peintres, qui vécut en Hollande entre 1606 et 1669. Je ne peux décrire combien étonnante fut sa découverte, mais les 176 pages de son livre traduisent la méditation qui s’en est suivie. Que quelqu’un accroche à ce point à une « image » peut nous surprendre, d’autant plus que Henri Nouwen était professeur à Harvard, la plus célèbre université américaine. Mais pour saisir quelque chose de cet émoi, faut-il rappeler ce que Charles Baudelaire disait déjà de la grande peinture, qu’elle n’est pas la chose facile et distrayante que l’on pense, mais un art qui peut nous introduire dans le monde mystérieux du sacré, là même où nos vies s’élaborent dans la profondeur.
L’art pictural peut donc bien représenter des scènes relatées dans la Bible et auxquelles la religion s’intéresse. Mais peut-être avons-nous le tort de comparer ces représentations picturales à des clichés photographiques ?
Avons-nous une idée de la démarche du peintre qui l’a conduit à créer un chef-d’œuvre aussi révélateur de la vie. En tout cas ce n’est pas seulement l’habileté picturale de Rembrandt qui explique la richesse et la puissance de l’œuvre. On peut penser que le peintre y a investi une part de sa vérité vécue, faite de confrontations multiples avec des vérités intérieures de l’âme que justement ce tableau s’efforce de représenter. D’ailleurs sa biographie révèle qu’il est parvenu à peindre ce modèle achevé du Fils prodigue qu’après une série de tentatives qui montrent bien que Rembrandt était en procès avec certaines modalités de son âme. Il lui fallait d’abord prendre conscience, en lui-même et par lui-même, de tendances rebelles et rancunières de sa nature avant de les transposer sur le tableau sous les figures du fils cadet (prodigue) et du fils ainé. La scène du tableau qui s’approche si étrangement du récit de Luc par le moyen d’une image globale synthétisant une série d’évènements spatiotemporels permis par l’art pictural, nous laisse croire que Rembrandt était parvenu à une compréhension profonde des données de la condition incarnée de l’homme et des moyens spirituels pour en convertir les tendances vagabondes. Car il faut bien préciser que la posture agenouillée du fils prodigue aux pieds de son père rejoint l’esprit du récit qui veut insister sur le retour au père comme au lieu d’Origine. Tandis que la posture altière du fils ainé veut traduire les résistances plus subtiles et les refus plus difficiles à déceler qui entravent un véritable retour au père alors même que ce fils vit avec son père. Ce cas laisse donc penser que le conformiste « bien correct » peut encore être éloigné du but; on le voit dans la réaction rancunière du fils ainé qui met du temps à accepter le retour de son frère au point que la parabole ne dit pas s’il y est parvenu.
Henri Nouwen a décodé un autre niveau d’interprétation que Rembrandt a su rendre par de subtils détails. En somme, le fils prodigue, c’est aussi Jésus qui est parti en exil dans le monde avec la mission de rappeler aux hommes et aux femmes leur dignité spirituelle au risque d’être méconnu et parfois maltraité. Quant au fils ainé, ce fils modèle que tout le monde respectait mais dont nous avons vu que l’égarement était plus difficile à cerner, peut-il être une figure de Jésus ? Bien sûr, puisque Jésus lui-même est présenté comme le Fils ainé du Père. Il est envoyé par le Père pour révéler l’amour inconditionnel de Dieu pour tous ces enfants prodigues et pour s’offrir lui-même comme chemin du retour. En conclusion, on peut dire avec Nouwen que « Jésus nous montre la véritable filiation. Il est le fils cadet sans la révolte, Il est le fils ainé sans la rancune. ».
Donat Gagnon
Images et impressions sur les rapports des êtres humains avec les animaux
par Donat Gagnon
Quelle image se fait-on du monde animal ?
La question a beau être simple, la réponse est fort complexe. La diversité des espèces animales est un fait observable et de plus en plus accessible grâce aux moyens de communication télévisuelle. Outre l’observation, il y a la perception de chacun qui regarde avec les moyens de sa sensibilité. Est-ce le regard du contemplatif transporté d’admiration devant la beauté animée d’un chat, d’un chien ou d’un cheval, ou encore d’un oiseau, d’un couple d’oiseaux faisant leur nid pour accueillir leurs oisillons ? Ces faits d’observation suscitent déjà des questionnements qui ont des consonances métaphysiques semblables à celles que les humains se posent sur eux-mêmes : d’où je viens, qui suis-je, où je vais ? En somme quelle est ma destinée ? Et bien sûr, quel genre de destinée pour les animaux ?
Oui, ces animaux qui rivalisent de beauté parfois ont-ils une destinée ? Nous accompagneront-ils dans la nôtre ? Étant donné que leur compagnie actuelle les fait proches de nous. Il doit bien y avoir des points de rencontre entre la nature animale et l’humaine tout en respectant les caractères respectifs des espèces et leurs degrés dans l’échelle des êtres. Ici on risque les faux pas, de tomber dans les catégorisations qui s’éloignent complètement de l’esprit contemplatif.
Pour le contemplatif, comme pour l’authentique sage, la différence entre les espèces vivantes et l’homme n’est pas si grande qu’on le prétend dans les discours pompeux de la supériorité de l’homme. Et je précise que les plus sages le disent. Par exemple un contemplatif comme saint François d’Assise quand il parle de sa sœur Lune et de son frère Soleil; de la même façon il traite les êtres animaux et les oiseaux comme étant ses frères et sœurs. Un tel regard, une telle reconnaissance fraternelle ne s’expliquent que par la conscience de l’interdépendance ordonnée de tous ces êtres dans un monde unique. Par ailleurs, on rencontre des personnes qui font preuve d’une attitude maternelle ou paternelle envers tous les êtres vivants. C’est personnes ont compris que les humains ont le devoir de les protéger, voire de les aimer. Mais comment justifier ou fonder un tel regard contemplatif ?
Du moment qu’il existe, un tel regard se passe des justifications et des démonstrations logicomathématiques. Il appartient aux domaines de l’âme et de l’esprit. Son mode de compréhension relève de la relation cœur à cœur et de la communion des âmes et des esprits.
-- Oh mais ! Les animaux là-dedans n’y ont point part puisqu’ils n’ont pas d’âme, très peu d’intelligence, et leur peu de sentiment fait qu’ils se dévorent entre les espèces.
-- Vous monsieur le sceptique, où avez-vous appris que les animaux n’ont pas d’âme, si peu d’intelligence et encore moins de sentiment ?
-- Ah bien, à l’école quand on étudie le classement des espèces. Il y a des espèces qui ont arrêté leur développement à des stades très primitifs qui les privent de l’attribut de l’âme. Un animal c’est un genre de matière utilisable ou exploitable pour les besoins de l’homme. On dit quelque part que l’homme détient le pouvoir sur la Terre et sur les êtres qui y vivent. En quelque sorte il a le devoir de les dominer, d’en faire ce qu’il veut. N’y a-t-il pas eu des théologiens qui auraient soutenu une telle thèse ?
-- Il est vrai que les théologiens ne sont pas tous de l’école de saint François. Certains se rattachent davantage à la pensée du philosophe René Descartes et à ses suivants qu’à l’esprit traditionnel qui accorde aux animaux la dignité de créatures divines appelées elles aussi à la résurrection. Saint Paul appuie fortement cette idée; et le livre de Job y fait aussi allusion. Le chien de Job subit le même sort que ce dernier; le plus fidèle ami de l’homme donne des signes de le suivre dans tous ses déplacements, jusque dans les états d’après mort. Les témoignages en ce sens ne manquent pas aujourd’hui même. À ce moment là, le sceptique me fit signe qu’il aimerait bien connaitre la pensée de monsieur Descartes sur les animaux.
Le point de vue de René Descartes sur les animaux.
Sans entrer dans les tenants et les aboutissants de sa pensée, je peux relever de la conception de ce penseur, des affirmations qui ratatinent considérablement la réalité et le statut reconnus à l’animal par les sociétés traditionnelles; parmi celles-ci, j’inscrirais aussi l’animisme et le chamanisme qui ont de nombreux adeptes à travers le monde, en Amérique, en Afrique, en Asie, par exemple au Japon avec son shintoïsme. Descartes ne manquait pas d’intelligence mais beaucoup d’histoires le troublaient. Pour cette raison, il s’arrangeait pour les faire oublier, et cela intéressait beaucoup de monde pour qui l’inconnu fait peur. Soulever la question de l’âme et les expériences qui s’y rattachent, cela jette déjà certaines personnes dans le scepticisme et le trouble. Par ailleurs, si l’on veut utiliser les animaux sans blesser la sensibilité humaine, on n’a qu’à se convaincre que l’animal n’éprouve pas de la douleur, de la souffrance et de la conscience. René Descartes a appris au monde à ignorer la sensibilité animale. Il a influencé avec ses collaborateurs la perception de l’homme moderne à l’endroit de la gent animale. Il affirmait avec le plus grand sérieux que l’animal est une machine; il est construit et se comporte comme une machine, c’est tout. Il appartient à la catégorie de l’étendue spatiale du corps.
-- Qu’est-ce qu’il peut bien y avoir de troublant dans l’étendue spatiale, reprit monsieur le sceptique?
-- Chez Descartes, le monde des corps est connaissable par l’étendue mesurable. L’étendue est un concept essentiel de la géométrie plane et analytique que ce philosophe rationaliste a développée. Quand on acquiert l’art de pratiquer ce type de géométrie, on découvre qu’on peut l’appliquer à n’importe quoi. Ainsi, on peut arriver à formuler des connaissances générales presque sur tout. Comme l’étendue spatiale est une façon de regarder les corps avec l’esprit de géométrie, il y a lieu de s’inquiéter des conséquences qui peuvent en résulter. En effet, l’habitude des chercheurs et des consommateurs de mesurer les corps avec la règle, le compas et la balance, si utile dans les travaux pratiques, a pour effet de ne révéler de la réalité des corps que l’information déjà impliquée dans la grille analytique sans plus, puisque le reste n’est pas très important; ce n’est plus la science!
C’est ainsi que l’animal en devenant un objet de cette science perd sa qualité d’âme aux yeux d’un très grand nombre. Puis, en vertu de la conception dualiste de ce philosophe qui s’applique à ignorer le plan de l’âme, ou plan intermédiaire entre le corps matériel et l’esprit de la conception traditionnelle, il faut conclure d’après ses principes que l’animal n’a pas d’âme et que son corps est une machine à la disposition de l’homme-esprit. Il affirme aussi que le corps de l’homme est également construit sur le modèle de la machine animale. Pour cette raison, il entrevoit qu’on pourra réparer le corps-machine comme on change la pièce défectueuse d’un véhicule. La médecine moderne a travaillé durant près de quatre siècles à réaliser ce rêve de Descartes. Il y a des résultats tangibles, surtout en matière de chirurgie. C’est à croire que la science médicale a réussi ce tour de force. Toutefois, cette entreprise plus ou moins illusoire et temporaire se met au service du point de vue le plus matériel de la réalité humaine et animale. Cela prête à conséquences.
-- Quels genres de conséquences ?
-- À première vue, on tire une grande fierté, même une grandeur morale, dans le fait d’atteindre au parfait contrôle de la machine-vivante. Certains caressent l’espoir de parvenir dans cette voie à l’immortalité matérielle. La théorie mécaniciste ou mécaniste de Descartes (c’est ainsi qu’on l’appelait fièrement au XVIIe siècle) a contribué à bouleverser la perception de l’homme moderne à l’endroit de l’environnement terrestre et des êtres qui l’habitent. Par sa conception de l’étendue mesurable, Descartes prétendait n’affecter en rien la réalité du corps. Ce dont on peut douter car il aurait plutôt contribué à ce qu’on voit les êtres vivants comme des choses, tout simplement parce que les corps soumis à ce genre de mesure (la règle, le compas et la balance) ignorent certaines caractéristiques au profit d’une lecture abstraite qui évacue la perception du vivant. Wolfgang Smith, en philosophe physico-mathématicien, s’est profondément intéressé à cette question dans son livre Sagesse de la cosmologie des anciens : Les cosmologies traditionnelles face à la science contemporaine. (Préface de Jean Borella, Traduction de l’américain par Jean-Claude Perret et Pierre-Marie Gigaud, publié aux Éditions L’Harmattan, 2008. Collections Théoria, 324 pages).
Dans son analyse critique de l’évolution des cosmologies scientifiques, cet auteur évoque les tentatives des sciences contemporaines à vouloir imposer des grilles abstraites qui éloignent de l’authentique perception de la réalité du corps. Les résultats ou les fruits d’un tel langage, y compris celui de la chimie si largement répandue, nous ont donné l’image d’un monde artificiel en perte de vitalité saine. Par chance qu’il y a d’autres points de vue plus forts que l’entropie et la mort pour compenser l’irréductible fatalité des effets de la science du bien et du mal ! Comme Wosfgang Smith, il y eut d’autres penseurs qui se sont élevés contre ce courant.
Gabriel Marcel le philosophe de l’Être et de l’Avoir
Il était temps qu’un philosophe français prenne la défense du sujet humain en dehors du cadre rigide du rationalisme de Descartes. Quand on ne voit plus l’absurdité dans le fait d’évaluer la valeur de l’humain en terme de quantité numérique, c’est le signe que l’homme lui-même est devenu un simple rouage interchangeable de la « machine de production » et « de la consommation ». Le mouvement de la machine est fascinant et impose à l’homme son mouvement artificiel et aliénant, plus ou moins selon les points de vue. La technique prétend libérer l’homme mais il est prisonnier plus que jamais de son rythme.
Personnellement j’ai mis du temps avant de comprendre une expression du philosophe de l’être et de l’avoir, je parle encore de Gabriel Marcel dans un de ses énoncés philosophiques : « je suis mon corps ». À première vue cette affirmation me semblait ramener tout l’être à ce qu’on entend généralement par le corps, c’est-à-dire un composé de matière vivante. Une telle réduction me plaçait devant le choix d’avoir à la rejeter ou au contraire à la comprendre tout autrement. Si je m’en tenais à la première interprétation, je devrais la rejeter car je ne crois pas que la réalité de l’homme et même de l’animal se limite à la façon matérialiste de voir les êtres. Par contre, il existe une autre façon de voir qui permet de résoudre ce dilemme.
En relisant Gabriel Marcel et en fréquentant certains de ses amis dont Jean Prieur, je me suis rendu compte que par son énoncé « je suis mon corps » Gabriel Marcel se trouvait à ébranler le point de vue habituel et matérialiste réducteur. En fait par sa formule, il souhaitait que dans la considération de l’homme, on soit capable de se distancer du point de vue habituel de l’avoir pour regarder l’homme au point de vue de l’être, avec ses prolongements dans la matière et dans l’esprit. En fait, quand il dit « je suis mon corps », il se pose comme sujet spirituel. Cette option lui permet encore de dire « j’ai un corps », c’est-à-dire ce corps est une modalité de l’être que je suis; ce corps matériel nait, connait la croissance, se maintient en vie par la nourriture des fruits de la terre et connait le vieillissement et retourne à la poussière. Si l’on ne s’en tient qu’à cette modalité corporelle matérielle, on est condamné à l’entropie et à la mort; par contre, le point de vue de l’être représenté par l’énoncé « je suis mon corps » s’affirme déjà comme existant dans une subjectivité et dans une subtilité qui désire se prolonger et survivre dans un corps-sujet-spirituel-personnel, qui est celui des plus grandes espérances de Vie et de Résurrection. Gabriel Marcel a eu le mérite de trouver le chemin d’un tel énoncé théorique. Jean Prieur a poursuivi l’entreprise dans une trentaine de livres très documentés dans lesquels les êtres vivants ont des « droits » d’existence.
On aura remarqué qu’entre ces deux pôles de la réalité, il y a tous les degrés d’existence des êtres vivants, tous les états des parcours des êtres particuliers qui sont animés : les plantes, les êtres vivants dans l’eau, sur terre et dans les airs, les esprits, les hiérarchies angéliques… les défunts ressuscités et les glorifiés. On aura remarqué aussi que l’âme est attribuée à tout ce qui vit au plan matériel et à des plans invisibles (ou plus ou moins invisibles selon les sensibilités). Ce constat théorique peut être plus largement démontré et surtout illustré à l’aide des textes traditionnels et des expériences vécues de nombreux témoins. Même les animaux y prennent part. Descartes aurait sans doutes rejeté une telle éventualité, comme plusieurs aussi qui disent avoir lu la Bible et n’ont pas remarqué les nombreuses mentions des animaux. Pourtant en ouvrant la Table pastorale de la Bible au mot animal, on y trouve une bonne soixantaine de références au Livre, sans compter celles portant sur le vivant, les bêtes et les brutes. En lisant les textes, il est possible de changer son regard et de se délester de certains préjugés. À défaut de rencontrer les bonnes personnes, on peut trouver les bons livres qui peuvent faciliter notre approche d’autrui, de notre propre intimité spirituelle et du dialogue créatif. Est-ce que notre interlocuteur sceptique nous suit encore ?
-- Je suis toujours là mais je n’ai pas moins de questions. Je dirais même que mes doutes sont très résistants. Quand on me parle de la Bible, ça me fait penser à des histoires qui ne sont pas prouvées. Pour cette raison, c’est peu crédible à mes yeux.
-- Ce que vous dites me rappelle une impression que j’ai quelquefois vécue au contact de certaines personnes qui disaient avoir lu quelques textes de l’Ancien ou du Nouveau Testament et ne pas avoir été transformées par ce genre de lecture. En leur demandant ce qu’ils avaient lu dans la Bible ou en tentant d’engager la conversation sur des passages précis qu’ils disaient avoir lus, je constatais qu’ils avaient très peu lu et très peu réfléchi sur des contenus. Il est vrai que beaucoup de gens sont absorbé par d’autres intérêts. Il y a aussi ceux qu’un texte reconnu inspiré peut laisser indifférents parce que ces personnes ne ressentent pas encore le désir de plus de compréhension de leur propre réalité et de leur entourage. Tant qu’on n’a pas connu un manque profond, un malaise existentiel, on ne semble pas prêt à se lancer dans une recherche de ce type. Mais nous ne sommes pas seuls. La vie se charge de nous provoquer avec son lot de petites épreuves. Les autres c’est-à-dire les humains et la pléiade des êtres vivants se chargent de nous harceler avec leurs dérangements et les questions qu’ils nous posent. Cela contribue à l’ouverture de la conscience et au questionnement personnel plus dynamique qui conduit aux désirs plus exigeants parce que plus fondamentaux. Au-delà de cette étape, il arrive parfois que le voile se brise pour laisser entrevoir que vraiment nous ne sommes pas seuls puisque notre propre vie et celle des vivants dans leur ensemble dépendent d’un même souffle créateur. Ce que je suis en train de dire peut se vivre de mille façons particulières et singulières. C’est comme s’il faut déjà avoir trouvé pour se mettre à chercher. Mais pourquoi encore chercher sinon pour mieux témoigner ?! En somme, quand on a vécu une expérience essentielle, la lecture d’un texte traditionnel ou simplement d’un texte inspiré n’est plus reçu comme une épreuve mais plutôt comme une belle et joyeuse récompense. Car le texte traditionnel vient confirmer la valeur d’une révélation personnelle. Un échange dynamique se fait alors entre le vécu personnel et le texte traditionnel, tous deux porteurs de signification.
-- Et cela donne quoi ?
-- Un témoin de plus ! Quelqu’un qui a touché à quelque chose d’essentiel qui peut prendre une multitude de noms presque équivalents : vérité, bonté, beauté, source, racine, amour, grandeur, lumière, vie, fraternité, solidarité, paix, justice, communion des croyants, interdépendance des êtres vivants, foi, connaissance spirituelle... Centre, Cœur et Joie.
Maintenant si l’on revenait à nos moutons, aux animaux de la bassecours et à tous les autres qui vivent d’un même souffle.
Mes contacts avec les animaux.
Étant fils de fermier, j’ai eu le plaisir mitigé de vivre à proximité des animaux. On élevait des poules, des moutons, des porcs, des vaches laitières et leurs veaux, des chevaux de traits. Le chien et les chats faisaient toujours partie de la garde des lieux. Toute ferme a besoin de ces derniers pour avoir un certain contrôle sur la vermine.
Mon premier souvenir remonte à ma prime enfance. Ma mère m’avait installé dans une chaise haute dans l’enclos à poules à l’extérieur par une belle journée ensoleillée. Ma chaise me servait de poste d’observation et m’évitait le contact des saletés répandues par les poules sur le terrain. Ce fut une journée de bonheur inoubliable. Un concert donné par des poules amuse bien un enfant de moins de deux ans. Je pense avoir été seul dans la famille à l’avoir éprouvé puisque je peux encore décrire la scène des poules dans l’enclos attenant au poulailler, alors que mon frère de trois ans et demi mon ainé n’arrivait pas à se souvenir de cet emplacement jusqu’au jour où la chose fut confirmée par une vielle photographie. Vous savez, on se rappelle toujours plus des évènements et des personnes que nous avons aimés.
À l’âge de quatre ans, j’ai vécu une expérience beaucoup moins agréable. Je me suis fait mordre par le chien de la ferme qui en avait assez de m’entendre pleurnicher à la porte de la bergerie, à l’intérieur de laquelle ma mère était en train de faire la tonte des moutons. Pourquoi ces pleurs, aurait pu demander le sceptique ? Simplement je désirais être à proximité de ma mère. Durant six mois j’avais été séparée de celle-ci pour passer tout ce temps avec mes parrain et marraine. On peut comprendre que je voulais combler le vide causé par mon éloignement de deux personnes très chères, en me rapprochant enfin de ma mère. Celle-ci savait que ma présence rapprochée aurait pu déranger les brebis. Mon récent retour à la maison ne m’avait pas encore permis de fraterniser avec le chien des lieux. Pour la fin de l’histoire, ce chien bâtard ne m’aura appris que la peur et laissé en guise de souvenir la cicatrice d’une dent de chien. Ensuite les ruades d’une jument et les morsures d’un cheval m’ont fourni des motifs de les craindre. Il faut en finir avec la peur, mais comment ?
La ferme traditionnelle de moyenne dimension abritait plusieurs espèces animales parce qu’on visait l’autosuffisance alimentaire et variée pour couvrir les besoins familiaux de l’année; et la balance des produits de ferme était écoulée aux marchés locaux, dans les coopératives laitières, céréalières et les boucheries. La diversité des travaux supposait des compétences qui n’étaient pas toujours au rendez-vous. Par exemple, l’abattage des bêtes pouvait tantôt prendre la forme d’une corvée. À cette occasion, l’habitué du coin ou le grand-père bon manieur de couteau devait se charger du sacrifice sanglant. Ce genre d’expérience obligé a horrifié ma conscience à chaque fois. Quand le grand-père n’était plus disponible, il fallait bien s’acquitter nous-mêmes de cette tâche, surtout en décembre. Avant le jour fatidique, mon père devenait plus anxieux. Cela se lisait à travers sa difficulté de choisir la bête à équarrir comme on l’entend de nos jours. Un après midi de décembre, alors que mon père sommeillait, mon frère et moi nous avions pris la décision d’abattre la « grande-noire », la vache préférée de mon père. Depuis quelques années, les « tireurs » de vaches souhaitaient que la « grande-noire » soit abattue pour le motif qu’elle n’aimait pas les jeunes qui s’approchaient d’elle pour la traire. Nous avons réussi notre coup, mais ce ne fut pas sans difficulté. Nous avons compris ce jour-là comment la bête, sentant sa mort venir, peut transmettre son anxiété à tous les animaux de l’étable. J’assume que ces animaux ne manquent pas de sentiment…
Nous étions en train de sortir les entrailles du corps de la vache quand le père est entré dans la batterie de la grange. Il s’y connaissait très bien pour la suite des opérations. Notre père ne nous a adressé le moindre reproche. Son anxiété avait pris fin. Le lecteur peut comprendre que ce genre d’évènement m’éloignait de toute ambition d’être fermier. Mais de tout cela n’allez pas conclure que je détestais les animaux. Au contraire, la douleur morale que j’éprouvais était, à la réflexion, une marque d’amour. Elle se manifestait au travers de la sensibilité, tandis que l’indifférence se passe de sensibilité. J’avais d’autres intérêts. Ma passion affirmée très tôt pour la connaissance a facilité mon acceptation de l’offre qui m’était faite d’entrer au collègue classique.
Surmonter la peur de l’animal
Au cours de la vingtaine, j’ai adopté un chien et quelques autres par la suite. Ils m’ont aidé à surmonter presque entièrement ma peur instinctive. Je dis « presque » car les « bergers » ne m’inspiraient toujours pas confiance, et de plus, à deux reprises, j’ai frissonné de frayeur devant un chien épagneul. La seconde fois remonte à quelque cinq ans. L’épagneul s’est présenté au moment où je mettais les raquettes pour faire une marche hivernale sur mon terrain forestier. Je n’avais jamais rencontré ce chien et je doutais de son amitié. Que faire ? Mais voilà qu’un petit chien du voisin s’amena et sauta vivement au cou de l’épagneul qui faisait dix fois sa grosseur. À voir l’insistance du petit pour faire arrêter le grand chien, je compris qu’il lui parlait… et la suite confirma cette impression. L’épagneul s’est calmé. Ma femme et moi, nous nous sommes engagés dans le sentier de la terre à bois; et les deux chiens nous ont suivis comme deux bons amis. Après quelque sept ou huit minutes, ceux-ci sont retournés à leur campement sur la terre voisine.
S’intéresser à l’étrangeté des animaux
Cette expérience m’a permis de comprendre quelque chose au langage des animaux. Si nous ne les comprenons pas, eux ils se comprennent. Plusieurs faits montrent que nous avons intérêt à les comprendre. Le petit chien Loulou de Poméranie de ma fille savait se faire comprendre par la qualité de son regard et de sa posture qui forçait notre attention. De plus, certains animaux familiers peuvent être porteurs de messages. (La fidélité du chien à son maitre est exemplaire au point qu’elle peut s’exercer au-delà de la mort. Dans certaines circonstances, son comportement met au défi la conception qu’on a des animaux. Pour illustrer la dernière phrase je dois me reporter à des témoins fiables de la profondeur du vécu expérientiel et du prodigieux. )
Passons à des exemples moins personnels. Par exemple, comment comprendre que les oiseaux et les quadrupèdes, pressentant l’imminence d’une catastrophe, se déplacent à temps en lieu sûr ? Comme d’habitude l’observation fréquente de ce phénomène a donné l’idée aux scientifiques d’inventer des appareils très sensibles capables de détecter des vibrations que les sens humains ne perçoivent pas. Mais ces appareils n’ont en rien augmenté la capacité humaine de ressentir et ne servent la plupart du temps qu’aux reporters pour décrire la gravité des catastrophes. C’est ce qui s’est produit lors du grand tsunami du 26 décembre 2004 touchant plus de 7 pays du Sud-est asiatique et de l’Océan Indien. La vague qui atteignait 30 mètres à certains endroits a tué 225 000 personnes, sans compter les blessés. Le tsunami était provoqué par un séisme sous-marin de 8.9 (échelle Richter) au large de l’Indonésie. On a vu les animaux monter sur les collines alors que les humains se prélassaient sur les plages touristiques pour les uns, ou vaquaient à leurs travaux quotidiens pour les autres.
Que l’on appelle cela sentiment, pressentiment, monition, prémonition, ce sont tous des mots qui désignent la capacité des âmes de ressentir les résonnances à différents niveaux de la réalité, à capter des messages dont on ne sait d’où ils viennent et à les rendre conformément à ce qu’exige la situation.
-- Ah oui mais cela c’est l’instinct !
-- Monsieur le sceptique, je vois que votre réaction n’est pas moins instinctive; je dirais même qu’elle est plutôt l’effet d’une habitude chez vous. L’instinct que vous prêtez aux animaux présente, selon moi, plus de subtilité que vous n’en percevez vous-même. D’autres avant moi ont dit que l’instinct est la chose la moins bien définie. Effectivement l’instinct peut tout aussi bien concerner des facteurs subconscients ou inconscients que des impulsions provoquées par le supra-conscient (ou le sur-conscient). Aussi bien dire que l’instinct représente la part d’inconnu qui commande l’action. Ce qu’on appelle instinct chez l’animal est l’expression spontanée de sa loi de nature spécifique. Chaque cas d’espèce semble jouer un rôle ou remplir une fonction qui s’accorde avec l’harmonie de l’ensemble cosmique.
Quand je faisais allusion aux animaux familiers pouvant être porteurs de messages, je pensais justement à des cas bien documentés qui démontrent que des animaux peuvent vivre ou se manifester dans les situations les plus incroyables pour sauver quelqu’un, prévenir d’un décès, inviter à produire une œuvre, etcétéra. Leur intervention quelquefois verticale surprend l’humain très porté à cloisonner les animaux sur l’horizontalité matérielle. Rien de mieux que des exemples pour donner du poids aux énoncés et arguments.
Un chien du nom de Nigel
Je commence par le cas de Nigel, un grand colley blanc, chien de garde de Mrs Wittlesey femme de pasteur. Le fait a d’abord été publié dans The Strange World of Animals and Pets et il fut repris par Jean Prieur dans son livre L’âme des animaux : « Ruth Wittlesey exerçait la fonction de surintendante d’une maison de convalescence de Hawthorn (Californie) rapporte Jean Prieur. En mars 1940, au milieu de la nuit, elle fut appelée au chevet d’une pensionnaire à l’agonie. Elle habitait assez près de son lieu de travail pour s’y rendre à pied, mais il lui fallait traverser un parc désert sans éclairage. Comme elle s’engageait dans cette zone sinistre, deux hommes en auto s’arrêtèrent à côté d’elle. Elle se mit à courir, ils la poursuivirent. À ce moment là, surgit Nigel, son redoutable chien de garde, un grand colley blanc. Il se plaça entre elle et les malfaiteurs qui n’insistèrent pas. L’animal accompagna sa maitresse jusqu’à la zone éclairée et disparut aussi mystérieusement qu’il s’était montré. Quand Ruth se fut remise de sa frayeur, elle réalisa que Nigel était mort l’année précédente. » (Jean Prieur, L’âme des animaux, Paris, Robert Laffont, 1986, p. 131)
Voilà ce que j’appelle un évènement signé par la verticalité. L’invisible donne un signe concret de sa présence pour aider la maitresse d’un chien; celui-ci décédé depuis un an donne en intervenant, une preuve de sa survie. Ceux qu’on a aimés se tiennent prêts, ils survivent et peuvent parfois donner signe de vie sur le plan terrestre. On savait que les saints défunts intercèdent pour nous, mais les animaux familiers feraient-ils aussi partie de la communion des saints ? La coexistence des animaux et des humains est-elle compatible sur un autre plan d’existence comme elle l’est d’ailleurs sur le plan terrestre ?
Le chien de Job
J’ai mémoire de deux cas de chien dans l’Ancien Testament. Le livre de Job fait état de la confiance et de la fidélité de Job envers son Dieu. Job était très riche mais homme bon. Un jour ses affaires se mirent à mal tourner. De jour en jour, il perdait ses biens, et plus il en perdait, plus ses adversaires le harcelaient sur les causes de sa déchéance et ceux-ci voulaient qu’il renonce à son Dieu qui, selon eux, ne lui apportait aucune aide. La sècheresse et la famine faisaient que ses bestiaux mouraient. Puis Job avait un chien, dit le livre, et ce chien était comme Job, c’est-à-dire fidèle à son maitre. Vous voyez que la fidélité du chien envers son maitre remonte à très loin.
Ariane Buisset dans Le Dernier Tableau de Wang Wei : Contes de l’éveil, (Paris Albin Michel 1988) p.95, plus précisément dans son conte Le chien de Job, a donné un prolongement à l’histoire de Job. « Tant que Job fut riche, dit l’auteure, ce chien fut gras et prospère, car tel père, tel fils, et tel homme, tel chien, mais quand Dieu se mit à faire pleuvoir toutes sortes de calamités, le chien qui n’était en rien concerné, pâtit aussi. Le comble est que la Bible ayant été rédigée uniquement par des humains, ce fait est complètement oublié ! Ah l’ingratitude de cette race ! Elle méritait bien le déluge ! » Cette histoire nous rappelle combien la conception anthropocentrique fait peu cas du destin des animaux. Avant de passer à un autre exemple, je tiens à ouvrir la parenthèse que voici :
Le statut des animaux dans la Genèse
D’abord je veux rappeler que dans la Genèse IX, 8 à 17, l’Éternel-Dieu répète cinq fois : « Pour moi je veux établir mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui se trouvent avec vous, oiseaux, bétail, et tous les animaux de la terre qui sont avec vous. » Il s’agit d’une alliance faite avec des être intelligents, conscients et libres; et les animaux sont concernés dans l’énumération. De plus en Genèse IX, 5, la responsabilité animale est reconnue; cela implique la reconnaissance d’une âme individuelle, consciente et libre. Ensuite l’alliance se gâte.
Les potentats de l’horreur
C’est sous Nemrod fils de Kush, raconte la Genèse, que l’Alliance divine-humaine-animale fut rompue. Le potentat de Nemrod, fondateur de villes, s’était engagé dans la voie des massacres d’animaux sous des prétextes sportifs. Ceux-ci furent suivis de massacres d’humains, de tortures et de camps de concentration... Le XXe siècle avait déjà ses précédents. L’utilisation des animaux pour faire toutes sortes de tests médicaux ou vivisections, à notre époque, a aussi été suivie par des tests sur la chair vive des humains. Rien de nouveau sous les potentats de l’horreur, n’est-ce pas ? La paix rompue entre les espèces est un fait observable, sauf exceptions car il y en a. L’état messianique est potentiellement à nos portes. Les bêtes ennemies arrivent à coexister et à sauver les petits de d’autres espèces parfois.
J’ai eu le bonheur de constater ce fait plusieurs fois ces dernières années. Par exemple, la femelle orang-outang, qui venait de donner naissance à son petit dans un arbre, doit déguerpir à la vue d’un léopard qui vient l’attaquer. Le petit laissé-là sur la branche, voire en suspension autour de la branche, est attrapé par le léopard qui le relève de sa fâcheuse posture. Il prend le petit sur lui dans l’attitude d’une mère protectrice. Quelle vertu ! Que cela est beau ! Il y a beaucoup d’autres cas semblables qui nous obligent à repenser notre rapport aux animaux.
Dans la lignée franciscaine
Saint François d’Assise avait dû penser à cela et tenté de tout faire pour rétablir une certaine harmonie. Il a été suivi par un petit nombre. Le pape François est dans la ligne de saint François si l’on en juge par le nom qu’il a choisi et son encyclique Laudato si. C’est un dossier lourd à porter car les adversaires ne manquent pas. Les destructeurs de la terre et de ses petits ne défendent que leurs intérêts économiques et s’engagent des détracteurs pour discréditer ceux qui plaident la cause des êtres vivants. En prenant parti pour les pauvres, ce pape propose un changement d’attitude à l’endroit des vivants et de leur maison commune, bien sûr la terre. De plus, il cherche à renverser la mentalité défaitiste et les comportements irresponsables. Son action courageuse pour empêcher de verser dans la tentation du suicide collectif rendu possible par les moyens techniques n’ont d’égal que l’esprit de compassion et de miséricorde de son discours; de quoi faire naitre en l’humain une nouvelle confiance spirituelle et le courage des décisions qui conviendraient pour le bien de tous.
La chienne Mascotte
Je ne veux pas m’attarder sur de nombreux cas d’animaux qui ont des comportements prodigieux. Je vais plutôt présenter une histoire vécue de Jean Prieur en présence de Marguerite qui pratique l’écriture automatique et de son amie Michelle. Marguerite pratique un don tout en étant sceptique et critique, tandis que Michelle croit aux messages sans avoir le don d’écriture. Par un après-midi ces deux femmes et Jean sont réunis.
Jean demande : Y a-t-il des animaux autour de nous ?
Réponse de l’au-delà par l’intermédiaire de Marguerite qui lisait au fur et à mesure ce que sa main écrivait : « Oui, il y a plusieurs chiens et chats, comme tout le monde, mais aussi un poney, une chèvre et un singe. »
-- Allons, tout ça n’est pas sérieux, s’esclaffe Jean.
Michelle, l’amie de Marguerite, intervient :
-- Mais si ! quand j’étais petite, j’ai eu effectivement des chiens et des chats, comme tout le monde, mais aussi un poney, une chèvre et un singe.
Jean la sent à la fois blessée par son hilarité et très émue de savoir que ces petites âmes se sont rassemblées autour d’elle.
Et Marguerite continue à écrire : « Quant à toi, Jean, il y a près de toi un berger allemand. »
-- Ah ! revoici Mascotte qui doit trouver le temps long de l’autre côté. Elle (la chienne berger allemand) se manifeste d’autant plus facilement qu’elle était médium en ce monde. Un après-midi de 1930, elle avait hurlé à la mort pendant un bon quart d’heure. Le soir même, arrivait un télégramme annonçant la mort de mon petit filleul âgé de cinq ans. Chose curieuse elle n’avait jamais rencontré cet enfant, aucun lien affectif ne la rattachait à lui. Le décès avait eu lieu dans l’après-midi à Audincourt, près de Montbéliard, et nous habitions à l’époque Maisons-Laffitte : cinq cents kilomètres nous séparaient. (Dans ce genre d’expérience, la distance n’a aucune importance pour les humains comme pour les chiens.)
Jean demande encore à Marguerite :
-- Est-ce que cette chienne est sans cesse auprès de moi ?
-- Non, elle te rejoint seulement dans la petite maison.
Marguerite ignorait à la fois l’existence de la chienne et de la petite maison des coteaux de Cergy. Quelques années plus tard dans ce lieu champêtre, Jean a senti sur le dos de sa main droite se poser un museau frais. Par contre, il n’a rien vu, rien entendu. Ce fut très net et très fugitif. Il l’a rencontrée périodiquement en songe. Il l’a revue en 1979, elle était devenue toute blanche et il lui disait, la croyant toujours sur le plan terrestre : « Mais tu as cinquante ans maintenant, on a jamais vu un chien atteindre cet âge-là ! »
Il y a plus. « Le 3 janvier 1981, dressée devant moi (Jean Prieur), elle posait ses pattes sur mes genoux et par télépathie (langage cœur à cœur) me disait : « Il est temps d’écrire ce livre sur les animaux ! » Je comprenais qu’elle me le demandait au nom de ses frères de race.
« Pourquoi ai-je cinq ans de retard ? Pourquoi ai-je tant tergiversé ? Je le sais maintenant. Parler des animaux, c’est prendre connaissance d’une documentation terrifiante, c’est faire une plongée dans l’horreur et explorer l’abime des aberrations et des cruautés humaines; cela dans tous les siècles et principalement dans le nôtre (XXe s.). C’est pénétrer dans un univers de cauchemar, c’est assister au massacre des innocents et se promener dans le jardin des supplices. (…) C’est assister à l’effondrement de la plupart des valeurs morales, philosophiques et religieuses sur lesquelles sont fondés notre édifice mental personnel et notre civilisation. » *
En guise de conclusion
Je m’excuse auprès de tous les êtres vivants dont on ne célèbre pas assez toutes les vertus. Toutefois, il faut reconnaitre aux sciences naturelles, le mérite de présenter des visages du monde animal qui imposent souvent notre respect.
La manière dont est présentée la mort est déterminante pour accepter les plus grands enseignements spirituels de l’Église catholique et des autres Églises qui croient en la Résurrection du Christ mais aussi des êtres individuels, y compris des animaux, si on a bien lu saint Paul, entre autres ses Épitres aux Corinthiens. Des siècles de méprises sur l’âme des animaux en contradiction des textes fondateurs donnent à réfléchir et à proposer des prises de conscience. Il reste à espérer que le message du présent pape François sur cette question, soit bien entendu.
La reconnaissant de la dignité « d’êtres vivants ou d’âmes qui souffrent les douleurs de l’enfantement dans l’attente de la résurrection » n’enlève rien à la destinée spirituelle de l’homme et de la femme. Il peut bien y avoir de la hiérarchie fonctionnelle, mais personne ne s’élève spirituellement en niant la fraternité des créatures qui proviennent d’un même Créateur. Que l’homme soit davantage esprit qu’il n’est âme se défend. Par contre beaucoup d’animaux donnent des signes de la survie ou de la première résurrection. L’accès à l’éternité est autre chose qui repose sur le désir et le choix libre de l’homme, et pourquoi pas aussi des animaux qui savent reconnaitre, quand c’est le cas, le rayonnement bienveillant des humains ? Quels saints serons-nous si nous n’avons pas de compassion pour les animaux et tous les petits ?
De plus, le caractère insondable ou inconnaissable de l’Infinité divine est peut-être attribuable au fait que Dieu est plus que le Visage humain de Dieu. Avec tout le respect qui est dû à ce Visage divin qui nous sauve et nous fait vraiment Fils et Filles de Dieu.
Donat Gagnon
22 mai 2016
____________________________
* Ce dernier récit de la chienne Mascotte est largement inspiré des pages 128 à 130 de L’âme des animaux. Par Jean Prieur, (Éditions Jai lu 1986, publié aussi chez Robert Laffont)
Jean Prieur, Cet Au-delà qui nous attend, Paris, Éditions François Lanore, 1974 et 1977,
Jean Prieur, Les témoins de l’invisible, Paris, Fernand Lanore, 1981
Jean Prieur, Les « morts » ont donné «Signes de vie », Paris, Éd.Fayard, 1976, Éd. Fernand Lanore, 1984.
Florence Faucompré, Nos animaux et l’Au-delà : Comment ils nous aident et se manifestent, Paris, Éd. Lanore poche, 2011.

